« L'ennui est après l'ambition le plus grand poison de la vie. »
Proverbe français
***
Mercredi 11 Novembre
Le plus souvent, lorsque rien de précis ne se profile à l’horizon, ni travail, ni rendez-vous, que les programmes de cinéma vous laissent indifférent, que vous êtes situé dans la zone d’incertitude sise entre la lecture de deux livres, vous n’avez de cesse, afin de vous changer les idées, d’aller faire une promenade au Jardin du Luxembourg. Le plus souvent, vous choisissez de vous asseoir sur l’une de ces chaises métalliques peintes en vert, sur le terre-plein qui domine le Grand Bassin, vous laissant aller à la plus douce des rêveries, celle qui, chez vous, chasse le spleen et ôte de votre esprit quelque chagrin qui aurait pu s’y loger. Certes vous êtes coutumier du fait mais, pour autant, vous ne souhaitez vous installer dans une routine qui serait contraire à la manifestation d’un facile bonheur. Toujours, dans votre imaginaire, l’espoir que quelque chose de nouveau surgira : une idée d’écriture, la concrétisation d’un rêve sous les espèces de la vision d’une scène inattendue, peut-être une rencontre qui orientera le cours de votre vie dans une direction dont vous ne pouviez soupçonner qu’elle pût exister.
Disons, c’est un clair après-midi de printemps, la nature s’éveille, les frondaisons du Jardin, les charmilles bruissent de mille pépiements joyeux. Aujourd’hui c’est un banc qui a retenu votre attention, près du Kiosque à musique. Vous avez pris un journal que vous feuilletez distraitement, plus à la tâche de regarder les allées et venues des passants qu’à une lecture qui vous paraît fastidieuse, les événements sont si gris qui maculent les pages. Vous vous distrayez de tout et de rien, le vol d’un pigeon, le jeu d’un enfant, le travail d’un Jardinier. Après un long moment de flottement, vous êtes sur le point de partir lorsqu’une Inconnue vient s’asseoir près de vous. Certes vous ne souhaitez la dévisager, ce serait un manque de tact. Cependant vous tâchez d’élargir votre champ de vision de manière à l’observer discrètement. Il s’agit d’une femme aux alentours de la quarantaine, cintrée dans un tailleur gris élégant. Sa chevelure est courte, claire, dans les blonds cendrés. Elle lit un livre dont elle tourne lentement les pages comme si elle en savourait le contenu. Vous pouvez lire le titre : ‘La maison de Claudine’ de Colette. Alors quelques phrases se précisent dans votre mémoire. Vous retrouvez surtout les passages lyriques des descriptions de la nature, des scènes de la vie.
D’évoquer ceci, c’est déjà comme si vous aviez entamé une conversation avec celle qui partage votre solitude. Au bout de peu de temps, vous devez vous avouer à vous-même ce genre de trouble délicieux qui vous envahit au seul motif de votre proximité d’une présence si discrète mais si rayonnante. Vous allumez une cigarette. Afin de vous donner une contenance ? Dans le but de tromper votre impatience ? Vous seriez bien en peine de délimiter l’essence de votre état d’âme. En tout cas vous vous sentez paradoxalement dans l’attitude de celui qui oscillerait entre optimisme et pessimisme, mais il faut le reconnaître, c’est bien là la marque de votre caractère. Peut-être est-elle accentuée par la situation qui vous installe dans la perplexité ? Que souhaitez-vous au juste ? Faire plus ample connaissance de l’Inconnue au tailleur ? Quitter ce banc et ne plus penser à rien ? Vous seriez bien incapable de le dire, ce genre de rencontre vous plonge toujours dans l’embarras.
Faisant mine de vous plonger avec attention dans la lecture de votre quotidien, alors qu’en réalité vous n’êtes qu’en vous hors de vous, vous entendez une belle voix voilée vous demander si vous avez du feu. ‘Seule’, vous la nommez ainsi, c’est un jeu chez vous d’attribuer des noms aux passantes que vous croisez au hasard de vos déambulations, ‘Seule’ donc a tiré de son étui une longue cigarette au filtre de liège. Vous saisissez votre briquet dont la flamme vacille au gré d’un vent léger. ‘Seule’ entoure vos mains pour abriter sa cigarette. A-t-elle effleuré vos doigts ? Vous avez senti une brève pression et, simultanément, votre cœur a battu plus fort. Mais n’est-ce pas votre imaginaire qui vous abuse ? N’est-ce pas déjà un désir qui s’allume en vous et vous pousse à la déraison ? Le peu de temps qu’a duré la flamme vous avez eu le loisir d’archiver en vous, ce beau visage énigmatique, de détailler la pulpe grenat des lèvres, les yeux couleur d’acier, les cils longs et ombrés, les beaux cernes mauves qui semblent dire l’étrange volupté.
Vous vous êtes énivré de ces fragrances de miel et d’ambre qui s’élevaient du tabac. Vous avez même pensé à un philtre d’amour. N’était-ce, dans ces feux illusoires du jour, une entreprise de séduction ? Déjà vous savez que vous êtes comme sous l’emprise d’un alcool fort, d’un puissant narcotique qui décidera de votre futur, abrègera vos nuits. Vous êtes un incorrigible séducteur, une manière de Casanova qui vous abreuvez à votre propre plaisir bien plutôt qu’à celui de l’Etrangère qui est à la racine de votre trouble. Vous êtes un homme double. Vous êtes Vous qu’habite un Autre homme, celui qui est né au contact de ‘Seule’ dont, maintenant, vous ne pouvez qu’accomplir la nécessaire efflorescence. Avec ‘Seule’ vous avez parlé comme dans un songe. Vous avez papillonné autour de son esquisse florale. Vous avez butiné par avance ses pétales, sa corolle intime, vous êtes entré en elle par effraction, vous avez percé sa peau, avez colonisé sa chair. Vous ne pouvez douter que ‘Seule’ vous appartienne, qu’elle tisse sa propre vie au contour de la vôtre, qu’elle soit, en quelque sorte, un satellite dont vous constituerez un centre d’attraction. Le seul qui soit possible en ce lieu, en cette heure.
Non, vous n’êtes nullement pervers, vous ne tirez nul plan sur la comète, vous laissez la liane de vos affinités capturer qui vous aimez dont vous pensez que l’amour vous était dû. Vous prétendez que nulle rencontre n’est le fait du hasard, qu’elle était inscrite de toute éternité dans votre propre tablette d’argile, dans celle de ‘Seule’ dont la trajectoire vous a enfin rencontré. Le rendez-vous pour demain à la terrasse du ‘Café Romain’, Place de l’Estrapade, est-ce vous ou bien elle qui en avez décidé ? Ou bien est-ce le motif de vos destins réunis ? Une confluence des cœurs anticipant l’osmose des chairs ? C’est si curieux une existence avec ses multiples événements dont il est bien difficile de démêler l’écheveau des causes et des conséquences ! Toujours un secret, toujours un mystère qui cryptent le réel, le rendent illisible.
Jeudi 12 Novembre
15 Heures - Vous êtes arrivé avec une bonne heure d’avance. C’est votre habitude. Elle résulte du souci de faire phosphorer le plaisir de la rencontre, de préparer un lit où elle pourra s’épanouir, prendre sens. Vous buvez en de minces gorgées un Canada Dry dont votre palais détaille longuement le pétillant des bulles, le goût tonique du gingembre. Chaque bulle, chaque touche épicée sont les signes avant-coureurs de ‘Seule’ dont, encore, vous ne connaissez le prénom. Elle a préféré vous réserver la surprise. Sans doute une façon d’aiguiser votre envie, de donner des gages à votre appétit. Dans la coursive étoilée de votre tête des prénoms se donnent au hasard comme possibles nominations : Claire, Hélène, Virginie, Eve. Aucun ne brille plus que l’autre. Peut-être ‘Seule’ est-elle une synthèse de toutes ces existences hallucinées ?
16 heures - Vous regardez compulsivement le cadran de votre montre. 16 heures est l’heure ‘fatidique’ au sens étymologique de ‘fatum’, ce destin irréversible qui joue de vous comme le ciel joue des nuages. Votre regard se perd au loin dans la longue perspective de la Rue des Fossés Saint-Jacques. Vous chercher à distinguer la silhouette de ‘Seule’. Vous scrutez tout ce qui vient à vous, qui ne manquera de vous offrir cette haute silhouette, cette chevelure blond-platine, ce visage qui vous habite comme si vous le connaissiez depuis le plus lointain du temps. Elle ne tardera à arriver. On n’est nullement une femme d’allure si élégante pour ignorer ses rendez-vous. Et puis, vous êtes sûr, hier, cette pression discrète sur vos mains, c’était un signe. Du reste vous ne vous y trompez pas, une longue fréquentation de vos conquêtes féminines vous a pourvu d’un flair indéfectible. Bien sûr, parfois une simple illusion que vous aviez transformée en certitude, mais ces erreurs d’estimation ont été si rares.
16 heures 15 - Nulle présence, dans le prolongement de votre regard, dont vous attendiez le surgissement. Elle aura eu un ennui de dernière minute, une course à faire, une toilette à repasser, un paquet de cigarettes à acheter. Elle est si libre quand elle fume, si attentive aux volutes grises, un rapide nuage visite ses yeux qui dit le plaisir de vivre ainsi, au bord des choses, dans la pure surprise d’être. Cependant l’inquiétude naît en vous, fait ses étonnantes confluences dans les noeuds de votre chair, dans le dédale de votre esprit. Vous cherchez, consciemment ou non, à vous distraire de vous, à vous éloigner de vous, pensant que ceci vous sauvera du déluge. Jamais vous n’avez observé avec autant d’attention le monde immédiat qui vous entoure, les pieds ouvragés de la table derrière laquelle vous êtes assis, le bourgeonnement des arbres, le grésillement des abeilles dans le peuple lisse de l’air.
16 heures 30 - Vous commencez à douter du réel, de vous, de ‘Seule’. C’est un peu comme si ce monde qui vous entoure n’était qu’une sphère de brume dans laquelle vous flotteriez immensément, ne percevant même plus les frontières de votre corps. Vous sollicitez votre mémoire, vous rejouez la scène d’hier à la façon d’une ‘scène primitive’ au gré de laquelle ‘Seule’ aurait été votre amante, l’unique amante de votre vie. Sa beauté, sa présence ont chassé toutes les autres. Les autres sont crucifiées, épinglées telles des insectes sur une planche de liège. Comment donc ont-elles pu exister ? Non, elles ne sont que l’ombre portée de Celle du Jardin du Luxembourg, elles s’évanouissent à son contact, elles brasillent dans l’illisible destin qui est le leur, un feu vite éteint dont nul n’aura même plus la souvenance, à commencer par vous, le ‘Solitaire’ de la Place de l’Estrapade, le « veuf, l’inconsolé », celui dont l’étoile est morte, dont Nerval traça dans le ciel de la littérature « le Soleil noir de la Mélancolie ». Les vers du Poète vous reviennent en tête et l’un d’entre eux, le plus incisif, se plante au plein de votre conscience à la manière d’un canif : « La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé. » Oui, la fleur s’est fanée avant même d’être cueillie et vous demeurez au centre de vous, éparpillé, fragmenté, oublieux de qui vous êtes.
16 heures 45 - Jamais vous n’avez regardé les choses avec autant d’acuité, de pure lucidité. Les arbres, là sur la petite Place, vous en détaillez les amples ramures, vous en percevez chaque feuille, vous en radiographiez le tronc, vous en percevez l’âme dans sa substance la plus blanche, la plus virginale et il s’en faut de peu que vous ne perceviez jusqu’au cheminement de leurs racines souterraines. En réalité vous ne faites que tromper votre attente, détourner la dague qui menace votre peau, sans doute l’incisera bientôt. Vous laissez flotter la rayon de votre vision sur les longs capots des voitures noires, glisser le long des trottoirs de ciment, inventorier la moindre lézarde, puis rebondir sur la silhouette de cette passante dont vous pensez, qu’aussi bien, elle aurait pu être celle de ‘Seule’ venant s’asseoir tout naturellement à votre table, s’excusant du retard, elle a eu un imprévu de dernière minute, mais ce n’est rien, cela n’entame nullement la joie de la rencontre, cela ne compromet en aucune manière ce qui aura lieu après car chacun sait bien en son fond ce qui adviendra, qui est tout simplement irréversible au simple motif que nul encore n’a pu faire s’inverser un destin, que certaines choses doivent se produire, tout comme la nuit succède au jour et l’accomplit.
17 heures - Déjà une heure passée à cette terrasse vide de la présence de ‘Seule’. Oui, pensez-vous, j’ai eu raison de lui donner ce nom ‘Seule’ qui, pour l’occasion, pourrait rimer avec le mien, ‘Seul’. C’est ce sentiment de longue solitude qui vous saisit ici et maintenant en cet instant mortel qui jamais ne se reproduira. Votre tête est cernée d’éclairs, de rapides fulgurations qui ne résultent que de votre dépit d’avoir été ignoré. ‘Seule’ vous la voyez nettement se profiler sur l’écran de votre imaginaire. Vous la voyez en discussion sur le banc d’hier avec un Inconnu. Ce dernier lui tend son briquet. Elle entoure de ses mains les mains de l’homme. L’homme sourit intérieurement. Cette pression sur ses doigts, quelle est-elle, quel mystérieux message se blottit au sein de ce léger attouchement ? Quel avenir se dessine ainsi ?
Malgré vos facultés de projection qui sont grandes, vous n’arrivez à cerner le visage de cet Inconnu du banc. Cependant, vous lui trouvez quelque ressemblance avec votre propre personne. Une façon de parler en faisant des gestes, une façon de regarder ‘Seule’, de l’aimer déjà à la hauteur de sa beauté. Mais qui est-il celui qui parait être votre sosie ? Ne serait-il l’incarnation de votre propre présence, un léger décalage dans le temps, la persistance rétinienne d’un événement, la promesse, en même temps, d’un futur qui chante dont, peut-être, vous pressentez en vous le doux bruissement de source ? Les choses sont si étranges dans ce printemps qui traîne à sa suite les joies et les tristesses des hommes et des femmes : une fuite à jamais dans la fente du temps !
Eloge de l’ennui - Quelques commentaires.
Faire l’éloge d’une perte, d’une affliction, d’une aventure qui a sombré dans le non-sens, ceci paraît risqué pour la simple raison que notre pensée fonctionne sur le mode de la logique, du rationnel et que prétendre préférer l’absence à la présence semble être pure entreprise de Sophiste. Bien entendu si nous raisonnons au premier degré, dans l’immédiate décision de nos attentes légitimes, nous dirons bien vite que l’ennui est un état d’âme négatif qui entraîne toujours chagrin, tristesse et autres contrariétés dont chacun préfère faire l’économie. Un bonheur, fût-il léger et de courte durée, est toujours préférable à l’expérience du malheur. Cependant il ne nous est nullement interdit de tirer d’autres conclusions que celles qui sont habituelles dans ce cas de figure. Si nous consentons à faire l’éloge de l’ennui c’est bien qu’une telle attitude doit trouver quelque part son juste fondement, son évidente justification. Donc le personnage de la fiction, dans cette optique, tire des avantages de sa mésaventure. Et de quelle façon ? Pour quels gains ?
Nous dirons que, de manière synthétique, ‘Seul’ a vu son niveau de conscience s’élargir de façon appréciable. Si tout s’était passé selon l’ordre des choses, que ‘Seule’ ait honoré son rendez-vous, que la ‘scène primitive’ ait eu lieu, que d’éventuelles rencontres s’en soient suivies, tout se serait déroulé dans la pure quotidienneté, tout n’aurait été, en dernière analyse, que banal, contingent, infiniment reconductible. Maintenant, si nous visons cette longue attente selon son versant positif, nous dirons ceci :
‘Seul’ a vu l’empan du temps s’accroître considérablement. Ce qui, dans le temps réel n’a duré que deux heures, de 15 à 17 heures, dans le temps fictif, imaginaire s’est vu octroyer un supplément temporel. Ce temps interminable dont la lenteur est la marque la plus évidente, pourquoi lui conférer un caractère seulement négatif ? Toujours nous nous plaignons de manquer de temps, de faire toutes choses à la hâte, de ne jamais pouvoir apprécier la densité de l’instant, de n’en jamais saisir que l’étincelle. Elargir la temporalité c’est lui affecter de nouvelles configurations, de nouvelles valeurs, la doter de significations qui ne peuvent que nous enrichir si nous prenons la peine d’y consacrer un examen véritablement objectif. Ici, bien entendu, il y a conflit entre notre naturelle impatience à voir se résoudre les problèmes et le don qui nous est fait de goûter le réel avec la méticulosité qu’il mérite. Cet ennui qui ne semble jamais en finir, n’est-il le sentiment ourdi par ‘le philosophe en méditation’ (voyez le tableau de Rembrandt), par le mystique en sa contemplation dans le désert, par le savant qui admire les constellations au-dessus de sa tête (voyez la belle assertion de Kant : « Deux choses remplissent le coeur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. »). L’on se doute, regardant avec justesse la réflexion kantienne, que l’état conduisant à ‘l’admiration’ et à la ‘vénération’ ne sauraient résulter que d’une longue patience, vertu indispensable au penseur d’infini.
Et, parallèlement à cet accroissement du temps, c’est aussi l’extension de l’espace qui a eu lieu. ‘Seul’ qui, d’ordinaire, centrait son regard sur sa propre personne, sur son intériorité, voici qu’il le déporte de lui, longeant la longue perspective de la rue, interrogeant les frondaisons des arbres, fouillant jusqu’aux racines pour y conduire son exploration perceptive qui, en même temps, est examen, approfondissement de soi. Ce qui, aussi, s’est largement déployé, c’est l’interrogation sur l’attente, inséparable d’un questionnement sur l’amour. Si, en une première estimation fondée sur un naturel égoïsme humain, ‘Seul’ n’avait aperçu ‘Seule’ qu’à la façon d’une facile ‘proie’, si le thème de la rencontre ne s’illustrait que dans la perspective d’un opportunisme, eh bien l’angoisse coextensive à l’ennui, au sentiment de dépossession, projetait maintenant une lumière bien différente sur la possible relation. Elle devenait, non seulement plus essentielle, mais précieuse car l’envisager ôtait de facto cette cruelle épreuve de solitude où rien ne parlait que le souffle du vide.
Or c’est bien la nouvelle disposition d’esprit relative à l’ennui qui a rebattu les cartes. L’ennui a réalisé les conditions mêmes au gré desquelles les choses peuvent se renforcer et prendre un sens nouveau alors qu’une relation éphémère et donjuanesque eût immolé l’amour à la possession d’un plaisir rapide, sans échange véritable, sans lendemain. Autrement dit un acte parmi tant d’autres d’une laborieuse quotidienneté. Le nécessaire retour sur soi de ‘Seul’ a constitué la quête selon laquelle, à la fois se découvrir en sa vérité, à la fois reconnaître ‘Seule’ en sa dimension de nécessaire et absolue altérité. En conclusion, c’est la nature profonde, l’essence d’une union des âmes qui a eu lieu au travers des singularités propres offertes par l’ennui. Et puis, en fin de compte, chacun, chacune, ‘Seul’, ‘Seule’ n’ont-ils trouvé dans cette singulière situation d’un temps se dépassant lui-même, d’un instant métamorphosé en éternité, le lieu de leur inentamable liberté ? Demeurés où ils sont de leur propre itinéraire, ils conservent la possibilité d’emprunter une autre voie, un autre chemin qui, peut-être, n’est que celui-là même du Soi en son plus lisible rayonnement !
Peut-être l’ennui constitue-t-il, non la face inversée de l’allégresse, mais son indispensable complément ! Il n’est que d’en expérimenter l’irrésistible force !



/image%2F0994967%2F20201114%2Fob_ff5114_1.JPG)
/image%2F0994967%2F20230421%2Fob_21c84f_aaa-copier.jpg)
/image%2F0994967%2F20230411%2Fob_53ef30_aaa-copier.jpg)
/image%2F0994967%2F20230411%2Fob_0c7a1e_bbb-copier.jpg)



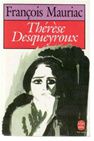
/image%2F0994967%2F20230403%2Fob_3c7a9c_ccc-copier.jpg)
/image%2F0994967%2F20230401%2Fob_a74f89_aaa-copier.jpg)

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)