Source : Librairie Dialogues
******
« Les Affinités électives est en même temps un roman d'amour, décrivant avec un détachement scientifique les mystérieux phénomènes d'attirance et de répulsion qui se jouent entre les êtres comme dans la nature… »
4° de couverture Garnier-Flammarion
« En chimie, on appelle affinité la force en vertu de laquelle des molécules de différente nature se combinent ou tendent à se combiner - « Il donna, en 1718, un système singulier et une table des affinités ou rapports des différentes substances en chimie ; ces affinités firent de la peine à quelques-uns qui craignaient que ce ne fussent que des attractions déguisées, d'autant plus dangereuses que d'habiles gens ont déjà su leur donner des formes séduisantes ».
« Geoffroy » - Fontenelle - Source : Littré.
***
Si la notion d’affinité peut s’illustrer de belle manière dans le roman de Goethe entre deux éléments qui, naturellement, paraissent soumis à des phénomènes « d’aimantation », les relations à l’intérieur d’un écosystème, dans l’ordre naturel, paraissent en être les données équivalentes. Mais laissons d’abord la parole à l’auteur des « Souffrances du jeune Werther » :
« Ce que nous appelons « pierre à chaux » est en réalité une terre plus ou moins calcaire, intimement combinée avec un acide subtil, qui nous est connu sous forme de gaz. Si l’on plonge un morceau de cette pierre dans une solution d’acide sulfurique dilué, celle-ci attaque la chaux et produit avec elle du gypse, tandis que l’acide subtil et gazeux s’échappe. Il y a séparation des éléments et apparition d’une nouvelle composition, ce qui fonde à utiliser la notion d’affinités électives, dans la mesure où tout se passe comme si une relation était privilégiée, choisie par rapport à une autre ».
Et, maintenant, si nous passons de la chimie aux relations internes qui existent entre tous les êtres vivants d’un écosystème, nous observons ce même type de schéma mettant en valeur les nécessaires liaisons participant à l’équilibre d’un milieu. Ainsi les crabes, les mollusques, les crustacés, les palétuviers, la fougère dorée, le manglier jaune et rouge s’assemblent-ils et forment-ils une famille qui concourt à l’équilibre de l’ensemble. La mangrove ne pourrait être en l’absence des palétuviers-échasses, lesquels ne pourraient être si les crabes les désertaient. La nature en son foisonnement nous donne l’exemple de ce que peut être une solidarité qui, bien entendu, parfois, semble assimilée à un simple opportunisme. Mais les choses de la vie ne sont ni simples, ni logiques et certains assemblages maintiennent en place l’architecture du monde. Concernant la qualité des liens établis entre les divers partenaires, le lexique est fourni qui se décline selon symbiose, association, mutualisme, commensalisme, parasitisme, coopération, toute la hiérarchie des motifs de l’alliance se donnant pour ce qu’ils sont, de purs mécanismes de défense contre cette irrépressible corruption dont la finalité est de tout reconduire aux ombres funestes du néant.
Affinités - Amitié - Amour
Sans doute serait-il tentant de transposer ces phénomènes de la nature, de les plaquer à la réalité humaine, sans qu’un intervalle puisse exister entre celle-ci et celle-là. Cependant le parallèle serait vicié dès l’origine pour la simple raison qu’un homme n’est ni une plante, ni un crustacé trouvant abri parmi la forêt dense de quelque palétuvier. Des affinités à l’amitié-amour il existe plus qu’une différence, c’est plutôt d’un abîme dont il faut parler. Si la faune et la flore vivent, l’homme existe. Il s’agit bien plus que d’une nuance. L’amitié d’un homme en direction de ses commensaux, l’amour d’une femme envers son amant, ne sont nullement des mécanismes naturels qui trouveraient leur explication dans une matière de causalité organique, comme la racine qui puise ses nutriments dans le sol qui l’accueille et la justifie. L’amitié, l’amour ne s’abreuvent nullement à la source des justifications. Ils puisent, originairement, à l’eau de la sensation, à l’affect brut, mais tout homme étant homme-de-pensée, bien vite le rationnel reprend ses droits qui soupèse, estime, rend ses jugements. L’aimée n’est pas une gemme sur laquelle on aurait jeté son dévolu à la seule vertu de son éclat. L’aimée est soupesée au trébuchet de l’entendement, de la lucidité et même si « l’amour est aveugle », il n’invalide les capacités de l’esprit à se saisir adéquatement des données du réel.
Si l’amour est passion, il n’en sollicite pas moins la lumière d’une intelligence en acte. Demeurer avec l’aimée équivaut à avoir fait un choix, lequel vient en droite ligne d’une délibération de la conscience intentionnelle, d’une résolution de la volonté. Seules ces assises créent les conditions d’une liberté. L’imposition d’une vie en commun serait-elle « naturelle », qu’elle se donnerait au prix d’un sourd fatalisme ne nous enjoignant que de suivre une seule et unique pente, autrement dit créant les conditions d’une aliénation. L’amour, que d’aucuns estiment « naturel » est un fait hautement culturel, ce que soulignait Lacan en des termes non équivoques : « L’amour est un fait culturel […] il ne serait pas question d’amour s’il n’y avait pas la culture ». Car aimer suppose la mise en place d’un récit intérieur, l’élaboration de projets, l’émission de concepts au gré desquels situer les sentiments éprouvés dans une échelle de valeurs. A la différence de l’animal qui ne copule que sous la poussée de l’instinct et à des fins de reproduction de l’espèce. Un genre de geste réflexe qui le ramène à la simple effectuation d’un mécanisme d’horlogerie. Pure immanence qui, jamais, ne s’élève au-dessus de sa propre nature. L’amour, l’amitié, sont ourlés de significations qui assurent leur mise à l’écart de toute action programmée. C’est par une libre décision de ma conscience que j’aime ou me lie d’amitié. Aucune loi n’en décide la venue au jour.
Et puisque la notion de « culture » a été abordée au travers des propos du psychanalyste, il convient de lui opposer, maintenant, selon une tradition bien établie, celle de « nature ». Car il existe bien une tension entre les deux, une constante dialectique qui les fait se situer sur deux monts opposés. Si l’amour est un fait culturel, ce qui ne semble pouvoir être invalidé que par une attitude sophistique, les affinités convenablement soupesées n’en réfèrent jamais qu’au monde naturel. Les affinités apparaissent en tant que fragments qui se seraient détachés de notre propre architecture, devenant, en quelque sorte, des satellites qui gireraient au large de nous en une manière d’appartenance spatiale dont nous aurions perdu jusqu’à la trace même du détachement mais qui, en de nombreux caractères s’y dévoilant, ne pourraient trahir leur appartenance généalogique, donc notre sol en tant qu’origine. En d’autres termes, ce curieux assemblage, le plus souvent hétérogène, d’intérêts divers, trace au-delà de notre présence les orbites par lesquelles notre condition s’assure de suffisantes coordonnées. Imaginerait-on un individu totalement dépourvu d’affinités que, provisoirement, nous nommerons « violon d’Ingres » et alors son existence ne serait qu’une suite de hasards dépourvus de points fixes, à savoir un chaos flottant éternellement au sein de ses propres indécisions. Car posséder des affinités n’est rien d’autre que de constituer notre égarement en cosmos, cette joie suffisante pour que notre horizon soit libre, notre vue dégagée, nos espérances hautes qui brillent au-devant de notre individuel cheminement.
Et puisque nous faisons l’hypothèse d’une fondation naturelle des affinités, ces dernières, de l’homme avec les choses du monde, doivent se révéler avant même que ne surgisse la conscience intentionnelle, la volonté, l’intellection et son produit, le concept. Nous pourrions dire qu’il s’agit d’une tendance pulsionnelle, instinctuelle, enfin de quelque chose relevant du domaine de la sensation plus que du logos, à savoir de la parole ou de la raison. Le phénomène est d’immédiate attirance, de spontanéité, de surgissement lié au corps bien plus qu’à l’esprit. C’est pour cette raison d’enracinement dans le roc biologique que la plupart de nos affinités, sinon toutes, demeurent inexplicables, mystérieuses, douées d’une aura dans la lumière de laquelle s’effacent nos motivations, ne demeurant que cet envoûtement, de fascination, de charme, toutes qualités qui font de nos « inclinations naturelles » ces petits riens insaisissables qui sont le sel des rencontres fortuites. C’est bien de l’inexplicable en nous dont il est question et nous nous sentons comme reliés à un long fil d’Ariane dont nous ne connaissons ni l’origine, ni la fin qui, peut-être, provient ou part en direction du labyrinthe et de son étrange dédale.
Du choix de quelques objets situés au centre de nos affinités
Ici, « objet » devra se comprendre en tant que terme générique désignant aussi bien une chose concrète, que des symboles, des présences humaines, des textes littéraires ou poétiques, des œuvres d’art. Donc « tout ce qui se présente à la pensée, qui est occasion ou matière pour l'activité de l'esprit » selon sa valeur étymologique. Car toute affinité, en raison même de son coefficient de proximité, se présente comme objet-sous-la-main dont, toujours, nous pouvons faire notre profit, entendu que, à la façon de l’écosystème qui s’est constitué à partir de notre propre être, tout ce qui s’y trouve relié au titre d’une « symbiose », d’une « association », d’un « mutualisme », tout ceci est à notre disposition sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande expresse à quiconque. Tout est naturel qui coule de source. L’un des prédicats les plus remarquables des affinités c’est la façon dont elles se donnent à nous dans l’immédiateté, dans l’évidente compréhension, dans la fluide participation à laquelle elles nous invitent. C’est, en quelque manière, une distance sans distance, un soi qui n’est totalement le nôtre mais le frôle, le concerne de si près que l’osmose est la figure naturelle dont se dotent ces harmoniques qui résonnent en nous, ces sympathies qui nous font signe, ces correspondances si singulières qu’elles nous définissent tout autant que notre propre caractère, la couleur de nos yeux, les goûts dont nous sommes affectés, les nuances qui tiennent à notre endroit le merveilleux langage du monde.
L’illimité des affinités
La déclinaison des affinités a ceci de particulier qu’elle se présente tel l’illimité. Les objets sur lesquels elle porte confinent à une sorte d’infini. Il peut aussi bien s’agir d’objets intra-mondains (une montre, un livre, un marque-pages), mais aussi bien une vertu (la tempérance ou la prudence), la lumière d’une poésie, le rayonnement d’une œuvre d’art. Et quand bien même ces objets seraient marqués au coin de la culture, leur mode de donation relève du surgissement naturel, tel l’eau dans la faille de la roche, l’élévation exacte du pic dans le ciel, le frémissement de l’arbre dans la brise d’automne. Toute l’argumentation qui se déploiera, tous les commentaires qui suivront, seront à percevoir selon le ressenti profond de ce réel qui se manifeste à nous, que nous ne pouvons ni éviter, ni métamorphoser que, cependant, il nous est possible de moduler au rythme, précisément, de nos affinités qui sont nos propres points de contacts avec le monde et tracent notre singulière présence sur cette terre. Donc nous dirons le-monde-pour-nous avec son épiphanie particulière, sa coloration intime, la confidence à laquelle, nécessairement, il invite. Bien évidemment, ici, nous sommes aux confins de la donation familière des choses, à la limite de l’imaginaire et d’une fantaisie en acte. Ou bien, peut-être, du rayonnement de l’utopie Mais comment pourrions-nous éviter ce réaménagement de ce qui nous entoure alors que le motif nous est donné, au gré de nos affinités, d’en remodeler la glaise et d’y imprimer notre propre sceau ? Pour autant cette entreprise n’a rien de démiurgique, elle ne bouscule ni l’ordre des choses, ni n’obère la vision que nous avons de l’habituelle factualité environnante, elle en décale seulement la perception et se voudrait humaine, simplement humaine.
De quelques liaisons affinitaires
Interroger quiconque sur ses affinités et vous verrez, devant vous, la figure d’un genre de dénuement. Comme si, subitement, le glacier des affinités avait fondu pour ne laisser place qu’à quelques flaques illisibles miroitant sous le feu de la question. Le problème de ceci même qui se trouve en accord avec la propre nature d’un individu est une notion si diffuse, si peu séparée de sa présence, qu’un état de confusion se montre, assez semblable à celui d’une personne aphasique manifestant un trouble de l’évocation. Donc un événement fusionnel dont il est difficile de saisir la propre autonomie. Ces mystérieuses affinités sont-elles bien réelles ou se confondent-elles avec notre « ton fondamental », autrement dit les caractères qui nous déterminent en propre ? Ensuite leur appréhension se double d’une si constante profusion de leur être que nous avons du mal à en discerner les formes, à tracer les esquisses selon lesquelles constituer une première évidence. Cette notion devient soudain si floue que nous pourrions abandonner sur-le-champ notre quête comme s’il s’agissait de poursuivre la trace de quelque licorne dont nous n’apercevrions même pas le début de la corne. Les affinités seraient-elles notre aura personnelle, une hallucination, une extravagance de l’imaginaire ? Si nous tentons de leur donner corps, voici que se montre un continent infiniment varié, une végétation luxuriante, telle la canopée, un fouillis telle la mangrove évoquée plus haut.
De quelques affinités dont nous pourrions dresser le portrait
Ce qui constitue une réelle difficulté en ce domaine, c’est le problème de la liaison des affinités entre elles. L’une d’elles est-elle évoquée, qu’aussitôt surgissent mille autres qui veulent faire entendre leur voix. Un peu comme une mise en abîme, des poupées gigognes s’emboîtant dans un genre de vertige sortant du champ de la représentation. Si je dis mon attachement à l’art en général, au moderne en particulier et, au sein de celui-ci, au cubisme, et plus précisément à l’œuvre de Picasso, me voici bien embarrassé pour établir une préférence, constituer l’ordre d’une hiérarchie, dire si c’est le coup de tonnerre des « Demoiselles d’Avignon » qui me questionne le plus, si, dans ce tableau même, ce sont les tonalités qui retiennent mon attention, le jeu des formes, ces masques fantastiques surgis de la nuit africaine, le graphisme des hachures, la spatialité réduite à un sans-fond. Je sens l’attirance, le magnétisme de ce tableau mais ne parviens nullement à décider ce qui, du sein de l’étrange, s’adresse à moi et draine mon désir sans que, jamais, un assouvissement puisse en conclure l’irrépressible radiation. Il y a comme une vibration de l’affinité qui, de proche en proche, gagne d’autres territoires, colonise d’autres districts. Picasso appelle Cézanne mais aussi, dans la totalité de son œuvre, d’autres hautes figures qui tracent l’histoire de l’art : Vélasquez et ses « Ménines », Delacroix et ses « Femmes d’Alger », Manet et son « Déjeuner sur l’herbe ».
Et cette adhésion aux œuvres n’est pas simplement question de goût car ce dernier résulte d’une longue maturation culturelle alors que les affinités sont naturelles. Elles sont une corporéité qui nous déborde mais avec laquelle nous conservons une attache charnelle. La chair onctueuse des Prostituées représentées dans les « Demoiselles », c’est un peu de notre chair qui rejoint la toile, un peu de la chair des modèles qui vient à nous et nous dit la difficile mise à jour de la peinture, ses esquisses plurielles, ses progrès, ses retraits, ses hésitations puis, soudain, le trait du génie et l’évidence existentielle faite art. Quelle que soit la sphère abordée, qu’il s’agisse de musique, de littérature, de sculpture, nous sommes toujours pris dans cet infini réseau des significations, l’immense ruissellement des textes ou des fugues musicales, les mots inouïs de la poésie. Si bien que nous avons du mal à nous y retrouver, à trier « le bon grain de l’ivraie », à ne laisser émerger à la surface de nos émotions esthétiques que celles qui nous emplissent d’un réel sentiment de joie. Ce qui nous égare au plus haut point c’est cette impression de fourmillement qui, toujours, nous déporte de nos propres inclinations. Alors, afin de réduire ce continuel effet de perte, il nous faut avoir recours à une forme qui synthétise nos affinités et en assure le caractère, en une certaine manière, intangible. Alors, par exemple, obligation nous est faite de rejoindre une très ancienne légende telle « L’Odyssée » et d’en constituer le lieu à partir duquel naîtra le site d’une pluralité de significations.
Musée du Louvre - Antiquités grecques - œnochoé à figures noires
(C’est subtil, les affinités, fragile, arachnéen et seul le sujet qui en éprouve l’efflorescence en soi peut en découvrir les esquisses infinies. Aussi, pour tracer un fil rouge qui reliera entre elles toutes ces délicates présences, en nous, convient-il d’indiquer, au travers de ce qui va suivre, l’émergence de ces affinités dans la figure du potier, cette saisissante alternative à tout démiurge, dans les éléments, terre, eau, air, feu, dont il assure la maîtrise, dans le geste artisanal qu’il développe, cet emblème du site de l’Anthropos, dans la scène mythologique dont il orne les flancs de son œnochoé, dans ces « figures noires, Ulysse et ses compagnons, le Cyclope, le transcendantal du Bien et sa figure négative, le Mal qui en ornent l’épopée, enfin l’épopée elle-même, ce poème du monde qui est le visage le plus accompli du logos. C’est essentiellement en ayant recours à la description et au commentaire que toutes ces sympathies s’illustreront faute de mieux car la sensation interne a ceci de particulier qu’elle ne peut jamais gagner l’extérieur qu’au prix d’une déperdition ou d’une euphémisation de son sens. NB : tous les termes surlignés en gras dans le développement ci-dessous, seront à considérer tels nos connexions électives avec le monde).
œnochoé à figures noires, 500-490, Peintre de Thésée
Ulysse et ses compagnons aveuglant le Cyclope
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Les frères Chuzeville
Ce magnifique pichet à vin de l’antiquité grecque nous servira à comprendre comment un seul objet, grâce à sa forte empreinte symbolique, pourra s’inscrire, pour nous, tel l’unique creuset dans lequel nombre de nos affinités convergeront, manière de cosmos en miniature chargé d’infinis pouvoirs et séductions. Car, ce dont il s’agit avec les affinités c’est rien de moins que de créer un monde si proche de qui nous sommes qu’il constituera, en quelque sorte, notre naturel prolongement, l’ombre portée que nous plaquerons sur les choses. Lieu d’élection de nos choix les plus intimes, nos affinités seront notre proche banlieue, un genre de chôra grecque telle que l’antiquité la montrait, ce territoire qui jouxtait la ville, cette terre qui, en réalité, nourrissait les habitants de la polis. Usant de cette métaphore de la ville qui serait le lieu propre de notre habitation alors que la chôra se donnerait comme cette terre nourricière qui nous serait immanquablement attachée, nous voulons souligner la nature du lien indissoluble qui réunit ces deux entités pour n’en constituer qu’une seule, singulière figure de l’unité dont l’homme est toujours en quête à défaut d’en proférer la réalité. La chôra contiendrait, dans son sol même, les semences perceptives, affectives, intellectuelles dont nous l’aurions gratifiée à l’aune de nos projections permanentes sur le monde immédiat qui nous entoure. Bien évidemment, sa constitution purement imaginaire lui affecterait la forme de l’utopie, ce non-lieu ne trouvant ses assises que dans un genre d’éther indéterminé. Ce qui est essentiel à saisir ici, c’est le continuel phénomène de réverbération qui s’installe entre notre être et les affinités qui, en un certain sens, lui sont coalescentes.
Le pichet et les connotations symboliques qui lui sont attachées
Si, essentiellement, ce pichet est œuvre d’art, c'est-à-dire s’il transcende le réel pour le rendre magique, il convient d’aller chercher tout ce qui, en filigrane, le traverse en tant que ses significations latentes. Car rien n’est donné d’emblée qui constituerait une totalité sans reste comme si nous observions un objet dans son extériorité sans même nous enquérir des puissances qui y sont à l’œuvre, mais dans l’indicible, l’inaudible, la fuite à jamais de ce qui, invisible, appelle silencieusement, ce dont notre être est alerté, que notre existence pressée n’archive que rarement. C’est bien le caractère de notre société technico-scientifique que de s’arrêter à l’épiderme des choses, ignorant cette pulpe (les affinités), qui en sous-tend la nature et en justifie la lumineuse présence.
Donc, si nous quittons le domaine massif et opaque de la représentation, la pellicule selon laquelle l’œuvre nous apparaît, c’est un genre de fête qui se manifeste et ceci d’autant plus que le sentiment de félicité qui en émane provient en droite ligne du surgissement de nos accords les plus propres avec les étants qui nous entourent. En son origine la plus exacte, cette œnochoé est œuvre artisanale qui sublime les quatre éléments, qui s’y inscrivent et les dispose selon les sens pléniers qui y sont nécessairement inclus. Mais alors il faut en appeler à la figure du potier et décrire le jeu de son art. Comment donner lieu à nos propres accords avec les choses autrement qu’en convoquant le langage ?
Potier dans la région de Zhaoxing
Source : fangfang
L’atelier est placé dans un lumineux clair-obscur. Le silence est grand dans l’heure qui vient. La plupart des villageois dorment encore, pliés sur leurs nattes, et leurs rêves flottent au-dessus de leurs corps rompus tels de légers nuages, des flocons qui viennent de très haut, hésitent, tournoient et frôlent leurs visages tels des papillons au bord des corolles. C’est de cette heure de repos, de cette heure immobile dont l’artisan a besoin car il lui faut être en affinité, en harmonie avec ce qu’il fait, ne nullement laisser s’immiscer ni le doute, ni l’inquiétude. Le trajet à accomplir de lui à la chose finie doit être aussi immédiat que possible, un genre de paix, de repos qui n’accepteraient nulle coupure. Un geste allant de soi. Un geste venu du plus loin de sa généalogie. Un geste de démiurge tirant du néant les matériaux qui l’annuleront, portant dans la clarté du jour ce qui n’était que tissé d’ombre et enduit de ténèbres.
C’est l’ensemble du corps du potier qui est mobilisé, on sent la tension légère des bras, on perçoit l’ouverture du compas des jambes qui accueille le tour, là où la motte d’argile est posée qui initie le début d’une épopée, esquisse le poème et le chant du monde. Oui, c’est bien ceci qui a lieu. Ici, dans la beauté partout répandue, c’est mystère qui se donne à voir. Mais mystère qui se livre à sa douce éclosion. Les mains façonnent la terre, la déploient en corolle et l’on pense à cette « rose sans pourquoi » de Silesius, à la façon contingente qu’à l’univers de nous rencontrer. Cette poterie en acte, aussi bien, aurait pu ne pas exister, demeurer dans le celé et l’inaperçu. Tout au plus aurait-elle pu être songe de potier qui l’aurait construite au sein de son esprit. Mais voilà, la glaise est là qui vient à elle et vient à nous dans la plus évidente et pure donation qui soit. Peut-être était-il écrit, quelque part, la graphie de son destin, la trace première d’une parution parmi le peuple des vivants ? Comment savoir la décision d’une chose d’apparaître, de faire signe et de nous convoquer à l’endroit même où nos affinités lui permettront de se manifester telle la figure qu’on attendait, une fiancée dont espérait effleurer la main de soie et ouvrir, avec elle, une commune navigation ?
L’eau exsude des parois, fait une buée qui lisse les murs enduits de chaux. Cette eau qui est le sang de la terre se donne à l’identique de la sueur du potier. Car dresser la terre est une épreuve en même temps qu’une douce gratification. Ce qui n’était qu’informe, virtuel, voici qu’une âme commence à l’habiter qui lui insuffle sa respiration, anime son souffle. A intervalles réguliers, à la façon d’une scansion temporelle, l’artisan trempe ses mains dans une boue de barbotine et l’applique sur le travail en train de s’accomplir tel l’amant caressant sa compagne. La terre n’est pas sans l’eau. L’eau n’est pas sans la terre. Magnifique fusion des éléments qui participe à toute création. Attraction réciproque d’un solide et d’un fluide qui, bientôt, seront métamorphosés en ce pichet qui n’attendra que l’action conjuguée de l’air et du feu pour connaître la façon de son émergence.
Le premier travail de façonnage est fini. Le potier a déposé la terre encore humide sur des claies de bois. Là commence le lent travail de séchage. Là commence l’action modificatrice de l’air. Dans l’ombre en demi-teinte de la pièce, l’air circule selon volutes et courants, lissant, au passage, les flancs de l’objet. Affinité encore de la matière et de l’air qui va la porter à sa consistance idéale, celle du cuir avec laquelle l’artisan poursuivra son travail, dégrossissant et affinant cette forme qui, bientôt, sera pichet, lequel servira à puiser le vin dans le cratère avant de le servir aux convives. Suivra la longue cuisson au feu de bois lors de laquelle l’objet, devenant terre cuite, s’approchera de son essence finale. Le feu, cet élément sauvage, il conviendra de le maîtriser, d’éviter qu’il ne s’emballe, qu’il ne provoque fissures et cassures. C’est sans doute là le moment de plus vive inquiétude pour le potier qui craint que son œuvre, patiemment élaborée, ne succombe à la proie des flammes. Dans un enfournement il y a toujours risque de cassure, de faille. De l’objet et, symboliquement, de celui qui en a été l’artisan. Puis, une fois la pièce cuite, viendra le moment peut-être le plus heureux du potier, celui de la décoration et de l’émaillage. C’est la fin et l’acmé du processus. Ce qui, jusqu’à présent, n’était que simple objet, ne devient seulement ustensile, mais essentiellement œuvre d’art. Il sera utilisé pour les libations profanes sans doute, mais aussi pour celles, sacrées, qui honorent les dieux et donnent sens à la vie des humains sur terre en cette antiquité placée sous le signe du rituel et du symbolique.
Le pichet vient de gagner son dernier état. Le voici placé dans la brillante lumière de l’esthétique. Il a cessé d’être une chose pour devenir être à part entière, c'est-à-dire tirer profit de son essence. Nul ne le considèrera plus comme un ustensile parmi d’autres mais en tant que cet ustensile doué de sens qui se détache du prosaïque et gagne les hauteurs qui sont les siennes. Sur ses flancs ornés d’un fond vermeil, cette teinte opulente et puissante destinée au Dieu-Soleil des incas ou aux têtes couronnées, ces sublimes « figures noires » qui sont les hiéroglyphes à déchiffrer qui nous conduiront dans l’une des plus sublimes épopées fondatrices de la civilisation européenne : « L’Odyssée ». Dès lors chacun comprendra combien ce pichet n’est celui de la modeste chaumière mais celui, symbolique, qui ouvrira la toute puissance du mythe, la force inégalée de la légende. Cet objet est si beau qu’il ne nécessiterait nul autre commentaire que celui d’une vision appliquée, respectueuse de ce rayonnement dont seul l’art possède l’énergie secrète. Cependant, afin de ne nullement demeurer sur le seuil de nos affinités, nous ouvrirons cette dimension à nulle autre pareille de l’œuvre d’Homère, citant un large extrait du Livre IX portant pour titre « RÉCITS CHEZ ALCINOUS », lequel relate l’épisode du combat contre le Cyclope :
» Il dit, et aussitôt je lui verse de cette liqueur étincelante : trois fois j'en donne au Cyclope, et trois fois il en boit outre mesure. Aussitôt que le vin s'est emparé de ses sens, je lui adresse ces douces paroles :
« Cyclope, puisque tu me demandes mon nom, je vais te le dire ; mais fais-moi le présent de l'hospitalité comme tu me l'as promis. Mon nom est Personne : c'est Personne que m'appellent et mon père et ma mère, et tous mes fidèles compagnons. »
» Le monstre cruel me répond :
« Personne, lorsque j'aurai dévoré tous tes compagnons je te mangerai le dernier : tel sera pour toi le présent de l'hospitalité. »
» En parlant ainsi, le Cyclope se renverse : son énorme cou tombe dans la poussière ; le sommeil, qui dompte tous les êtres, s'empare de lui, et de sa bouche s'échappent le vin et les lambeaux de chair humaine qu'il rejette pendant son ivresse. Alors j'introduis le pieu dans la cendre pour le rendre brûlant, et par mes discours j'anime mes compagnons, de peur qu'effrayés ils ne m'abandonnent. Quand le tronc d'olivier est assez chauffé et que déjà, quoique vert, il va s'enflammer, je le retire tout brillant du feu, et mes braves compagnons restent autour de moi : un dieu m'inspira sans doute cette grande audace ! Mes amis fidèles saisissent le pieu pointu, l'enfoncent dans l'œil du Cyclope, et moi, me plaçant au sommet du tronc, je le fais tourner avec force. — Ainsi, lorsqu'un artisan perce avec une tarière la poutre d'un navire, et qu'au-dessous de lui d'autres ouvriers, tirant une courroie des deux côtés, font continuellement mouvoir l'instrument : de même nous faisons tourner le pieu dans l'œil du Cyclope.
Tout autour de la pointe enflammée le sang ruisselle ; une ardente vapeur dévore les sourcils et les paupières du géant ; sa prunelle est consumée, et les racines de l'œil pétillent, brûlées par les flammes. — Ainsi, lorsqu'un forgeron plonge dans l'onde glacée une hache ou une doloire rougies par le feu pour les tremper (car la trempe constitue la force du fer, et que ces instruments frémissent à grand bruit) : de même siffle l'œil du Cyclope percé par le pieu brûlant. Le monstre pousse des hurlements affreux qui font retentir la caverne ; et nous, saisis de frayeur, nous nous mettons à fuir. Le Cyclope arrache de son œil ce pieu souillé de sang, et dans sa fureur il le jette au loin. Aussitôt il appelle à grands cris les autres Cyclopes qui habitent les grottes voisines sur des montagnes exposées aux vents. Les géants, en entendant la voix de Polyphème, accourent de tous côtés ; ils entourent sa caverne et lui demandent en ces termes la cause de son affliction :
« Pourquoi pousser de tristes clameurs pendant la nuit divine et nous arracher au sommeil ? Quelqu'un parmi les mortels t'aurait-il enlevé malgré toi une brebis ou une chèvre ? Crains-tu que quelqu'un ne t'égorge en usant de ruse ou de violence ? »
» Polyphème, du fond de son antre, leur répond en disant :
« Mes amis, Personne me tue, non par force, mais par ruse. »
Entrelacement des affinités entre le poème homérique et le récit épique chez Rabelais
Le texte homérique est si admirable que sa lecture se suffit à elle-même, cependant, dans le souci de dire nos affinités avec le logos du Grec, nous nous livrerons à de rapides commentaires. Vision du monde et malice homériques sont de si singulières aventures que tout lecteur attentif à cette épopée ne peut entrer dans ces pages sublimes qu’avec ravissement. Partout se donne à entendre le génie de l’écriture qui n’est nullement prouesse technique mais fore bien plus profond, tout au contact des ombres fuligineuses de la psyché et de l’étonnant réservoir de l’inconscient. La description de l’agression du Cyclope ne se contente nullement de dire la réalité des choses avec précision, mais elle fait de cette sanglante entreprise un moment de pur bonheur, Ulysse et ses compagnons métamorphosant Polyphème en un champ de bataille sanglant où désir de vengeance et cruauté esthétique se renvoient la balle dans une manière de jouissive puissance. Ce géant qui, sans doute, se pensait inexpugnable, le voici livré à la vindicte de ses assaillants dont la bravoure, l’énergie peu commune, concourent à faire de son corps un ensemble de chairs mutilées d’autant plus sensibles que l’œil unique du Cyclope est réduit en lambeaux. Ici, comment ne pas penser aux pages éblouissantes de l’admirable Rabelais, prenant un malin plaisir, dans la Guerre Picrocholine, à relater sans ambages ni précautions oratoires, le très fameux et très vigoureux assaut de Grandgousier contre son voisin Pichrocole. En réalité, un évident parallèle peut être établi entre le déchaînement antique d’Ulysse contre Polyphème et la « furie humaniste » lancée par Rabelais à l’encontre de ces fouaciers qui ne suscitent que détestation et impérieux désir de les détruire. Le pieu pointu convoqué par Homère, afin de procéder à ses sinistres œuvres, est l’exacte réplique « du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing » dont Rabelais arme le bras de Frère Jean des Entommeures afin que « justice » soit rendue.
Quant au raffinement des supplices en tous genres, à leur dimension ultra-chevaleresque, les deux textes rivalisent d’ingéniosité, et l’on ne pourrait dire lequel des deux sort victorieux de ces joutes fictionnelles. Ce que « L’Odyssée » présente comme le sommet de l’art guerrier (« Mes amis fidèles saisissent le pieu pointu, l'enfoncent dans l'œil du Cyclope, et moi, me plaçant au sommet du tronc, je le fais tourner avec force […] Tout autour de la pointe enflammée le sang ruisselle ; une ardente vapeur dévore les sourcils et les paupières du géant ; sa prunelle est consumée, et les racines de l'œil pétillent, brûlées par les flammes"), donc cet « art de la guerre », Rabelais en réalise une manière d’hyperbole, portant au paroxysme de la violence doublée d’un humour grinçant, les faits et gestes de ses héros (« Il choqua donc si raidement sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porcs, frappant à tors et à travers, à la vieille escrime. Aux uns il escarbouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres disloquait les spondyles du col, aux autres démolissait les reins, aplatissait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents en gueule, abattait les omoplates, meurtrissait les jambes, décrochait les hanches, déboîtait les bras… »)
N’oublions pas que Rabelais, en médecin avisé, détaillait un luxe de précisons anatomiques, chirurgicales, ces habiletés trouvant leur équivalent dans la maîtrise « artisanale » d’Homère : « l’artisan [qui] perce avec une tarière la poutre d'un navire ou bien le coup de main du « forgeron [qui] plonge dans l'onde glacée une hache ou une doloire rougies par le feu pour les tremper ». Ces tableaux, qui mettent en lumière la brutalité humaine, sont naturellement tempérés par ces excès, toute emphase en ce domaine penchant en direction du sourire du lecteur, lequel est complice du « clin d’œil » des auteurs. C’est bien là la nature de l’excès, de l’exubérance, que de ramener le récit à sa juste valeur. Nous sommes dans la légende avec « L’Odyssée », dans la satire avec « Gargantua » et le combat épique. Nous regardons tout ceci avec un regard distancié et savourons la malice qui, en tous endroits, perce et nous ravit, nous enjoignant de poursuivre notre lecture avec l’audace tranquille de quelqu’un qui sait le projet et l’accueille selon sa nature.
Citant des passages du « Quart Livre » riches en cruautés diverses : « Au second coup il luy creva l’œil droict ; au troyzieme l’œil guausche. » (que l’on pense au terrible destin de Polyphème à l’oeil détruit par ses assaillants), Dorothée Lintner, dans un superbe article intitulé « LE COMBAT DANS LE QUART LIVRE : RENOUVELLEMENT D’UNE TOPIQUE EPIQUE CHEZ RABELAIS », nous invite à regarder l’œuvre du natif de La Devinière avec un regard esthétique plus qu’avec celui du guerrier :
« Mais, à y regarder de près, on s’aperçoit que ce combat d’un type nouveau donne lieu à une réaction elle aussi nouvelle, qui ressortit moins de la joie brutale que du plaisir raffiné : la figure géométrique que construit Pantagruel ravit son public, suscite moins une curiosité malsaine qu’une véritable contemplation esthétique. […] l’imagination débridée quant à elle, offre de nouveaux horizons à la geste épique, loin du champ de bataille un peu étroit du pays tourangeau. Autrement dit, dans ce nouveau livre, l’imaginaire épique ne connaît plus de limite : l’œuvre travaille avant tout à esthétiser le combat, ce qui la rend elle-même du même coup nettement plus poétique. On peut se demander, finalement, si l’épopée rabelaisienne ne se singulariserait pas au fil des œuvres, dans sa forme même : ce récit dont le premier livre s’apparente à ces mises en prose de gestes médiévales, telles qu’on les publie abondamment au début du siècle, semble acquérir, dans ce quatrième opus, une certaine autonomie poétique. Aux combats esthétisés, aux voltiges impressionnantes des personnages, à l’épisode obligé, depuis Homère, de la tempête, répondrait une écriture épique tout aussi virtuose. »
Ainsi prennent fin, temporairement, nos affinités avec ces merveilleux textes que constituent « L’Odyssée » aussi bien que « Le Quart Livre ». Entre eux, de toute évidence, des liaisons qui dépassent l’analogie pour gagner ce site incomparable où brillent accords, alliances, attractions, convergences, autrement dit ces affinités par lesquelles nous sommes au monde d’une manière singulière qui ne peut être, à chaque fois, dans le temps et l’espace, que la nôtre. Sans doute contribuent-elles à fixer le lieu privilégié de notre essence. Oui, privilégié !







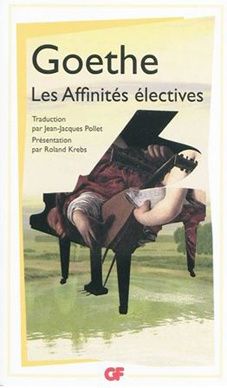





/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)