





VI - La chute
Callonges. Automne 1980
Début octobre et déjà les premières morsures du froid. Venu des plaines, le vent glisse le long des berges du Dol, remonte la pente de Tertre Rouge, balaie les immeubles de béton, s’engouffre dans le goulet de la Combe Gignac puis ressort entre les lèvres blanches du causse en de longs tourbillons qui font voler les feuilles. Sur son lit, dans « La Maison Perdue », Marie-Odile ne dort pas. Les idées courent dans sa tête avec la même obstination que le noroît sur le granit usé. Entre deux accalmies elle entend, au fond de la pièce, le souffle rauque et irrégulier de Milien, ses rêves à voix haute, parfois ses délires qui ressemblent aux cris aigus des corneilles, à la course des rats dans les combles remplis de ténèbres.
Elle remonte son plaid de laine, se tourne sur le côté. Elle sait que le sommeil ne viendra plus, qu’il lui faudra attendre la pointe du jour avant de se lever. Que les heures seront longues à user entre les quatre murs de pierre, dans le jardin envahi de lierre et de lichen, au milieu de la combe où jamais personne ne passe, sauf quelques animaux en maraude. Les tensions courent longtemps dans sa cage de chair, jusqu’à l’épuisement qui la fait sombrer un instant dans un état cotonneux dense comme la mousse.
Alors elle revoit en rêve son long périple à Callonges, ses jours de couture sous la lumière grise, l’incapacité de Milien à se fixer sur une tâche précise, son obstination à jouer de l’accordéon dans les rues étroites, du côté de la cathédrale, sur la Place du Marché ; elle revoit les ensembles, les tailleurs qu’elle apporte à son oncle Gary dans de grands papiers de soie beige, leurs repas dans la salle basse et enfumée de La Table d’Epicure ; elle entend les rires qui fusent, une joie tout innocente, simple, où chaque jour est un accomplissement, un cercle parfait qui se suffit à lui-même.
Puis une brusque déchirure, les longs couloirs blancs de l'hôpital, le ballet des infirmières, des médecins, le diagnostic sans appel, la mort de Gary il y a dix ans, à la suite d’une pneumonie aiguë ; la douleur, le travail qui vient à manquer, les petits travaux de ménage, parfois quelques retouches pour les magasins de prêt-à-porter ; enfin la longue descente vers les franges, les marges, le côté ombreux des rues, la vie recluse dans « La Maison Perdue », le glissement de Milien dans la déraison, les yeux dans le vague, le langage à la dérive.
Le vent a forci, cinglant les angles de pierre, lacérant les ronces et les genévriers, usant les moignons de calcaire, les tubercules des souches, les racines noires qui courent sur le sol. Pour Marie-Odile le réveil est long, douloureux, les muscles noués, les os perclus d’humidité. Sur le réchaud émaillé elle met de l’eau à chauffer pour le café. Elle en boit quelques gorgées lentement, laissant ses mains se réchauffer au contact du bol. Mélangé à la chicorée, le maigre fumet s’est répandu dans la pièce, a réveillé Milien qui réclame sa boisson chaude comme le ferait un enfant capricieux. Marie-Odile cale son dos avec un coussin, l’aide à laper un peu de liquide, prenant soin de ne pas trop incliner la tasse pour éviter l’engouement, faciliter la déglutition.
Milien est si fragile, juste la transparence d’une porcelaine. Alors, avant de le quitter, elle prend mille précautions. Elle l’assoit sur son fauteuil d’osier, tout près du poêle où rougeoient quelques braises, elle le couvre de son plaid, glisse entre ses mains une vieille revue de L’Illustration qu’il consulte compulsivement, émettant parfois de petits grognements de contentement, parfois des plaintes, des soupirs de désapprobation. Marie-Odile prend son cabas de toile cirée, tire la porte sur elle sans la fermer complètement. L’air, venu du nord, est sec, coupant. Elle descend le long de la combe sur le chemin de gravier envahi de lianes d’églantiers, de bouquets d’orties, des maigres tiges des bouillons-blancs.
VII - Une lumière en hiver
Dans la côte de Tertre Rouge, quelques voitures la dépassent, chargées de fruits et de légumes. Puis les premiers immeubles de la cité, le Centre communautaire avec son grand toit de tuiles rouges, ses piliers de bois vernissés, ses immenses verrières, son jardin clôturé où jouent de tout jeunes enfants. Parfois elle en franchit le seuil, avec hésitation, retenue, mais le désir est plus fort. Ce qu’elle aime surtout, c’est parler avec Angèle David, l’assistante sociale, lui raconter sa vie d’autrefois, Boulevard du Temple. Alors, au fond de son sac, elle a toujours avec elle de vieilles photographies qu’elle montre avec fierté et nostalgie : son père en costume de golf, prince de Galles ; sa mère en robe noire et chapeau façon Coco Chanel, une rivière de perles autour du cou ; elle, Marie-Odile, à l’âge de huit ans, vêtue d’une robe courte qui dévoile ses genoux, un empiècement de toile plissée sur les épaules ; un vieux catalogue du Cirque d’Hiver ; une vue du Canal Saint-Martin au Square des Récollets ; son oncle en 1910, en habit de fantassin et, pêle-mêle, quelques tickets de métro, de cinéma, des bouts d’agendas avec des notes manuscrites, des bons de livraison du Sentier, des feuilles séchées du Square Pasdeloup. A peu près tout ce qui lui reste de son enfance, de sa jeunesse avant sa fugue avec Milien pour rejoindre Callonges, la suite des jours heureux puis la brusque plongée, la descente dans une spirale sans fin après la disparition de son oncle.


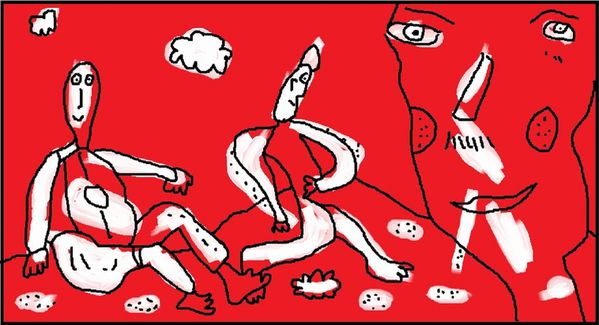

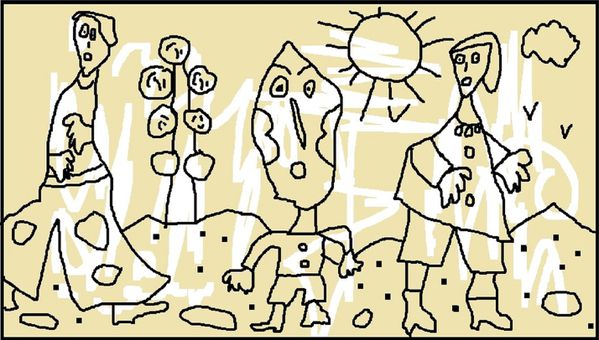

III- L’Accordéoneux
Paris. Eté 1932
Dans sa chambre Marie-Odile pique les poches d’un gilet, met un dernier point à une boutonnière. Puis elle se lève, ouvre la fenêtre. Les platanes, sur le boulevard, font une longue coulée verte pareille à un nuage d’eau. Quelques enfants, dans le square, jouent à se poursuivre autour de la fontaine au pélican ; des femmes en ombrelles sortent de la bouche du métro. Au café Glacier, à l’angle de la Rue Amelot, les tables se remplissent peu à peu. Derrière les murs du Cirque d’Hiver on brosse les alezans, les écuyères s’habillent de tulle, les jongleurs font tourner leurs massues. Dans un peu moins d’une heure les portes s’ouvriront sous l’éclat des projecteurs, l’orchestre enverra ses premières notes de musique.
Dehors aussi, dans l’air qui se teinte de mauve, l’éclat de quelques notes, les plaintes d’un accordéon dont on joue gauchement, sorte de pot-pourri de musette et de rengaines de music-hall. Dans la rue les regards se tournent et découvrent, tout près du square, le musicien assis sur un pliant de toile, un gobelet de carton à ses pieds. Du haut de son balcon, Marie-Odile a aussitôt été attirée par cette ritournelle étrange, jouée avec l’innocence d’un enfant. Elle regarde un moment ce spectacle improvisé. Quelques bambins jettent un peu de monnaie dans la sébile et ça fait un bruit semblable à la pluie sur un toit de tôle. L’homme est d’apparence jeune, plutôt fluet, ses yeux dissimulés derrière des lunettes à monture d’ébonite, cintré dans un costume gris, de grandes chaussures de cuir à ses pieds. Ses mains longues et fines glissent sur les boutons de nacre, hésitantes comme les premiers pas d’un funambule.
Marie-Odile referme la fenêtre, descend les marches de bois. Au rez-de-chaussée son père repasse des toiles dans un air embrumé de vapeur. Elle décide d’aller faire quelques pas en direction de Filles du Calvaire, pour dégourdir ses jambes, s’aérer, profiter des derniers rayons du soleil qui remontent le boulevard depuis la Bastille dans une sorte de nuage doré. Alors, dans son esprit, c’est une brusque illumination, comme si, l’espace de quelques secondes, le temps s’était inversé, qu’il avait reflué jusqu’à ce jour gris et pluvieux où elle était allée, Rue de Bretagne, faire sa livraison. Elle revoit, dans le jour glauque de l’entrée des Blancs Manteaux, la Religieuse dans ses voiles clairs, la silhouette évanescente du Pensionnaire venu récupérer son deux pièces de serge grise. Mais oui, l’évidence est là, l’accordéoneux du Cirque d’Hiver n’est autre que l’orphelin à qui elle a livré, il y a deux ans, le costume taillé par son père, qu’elle-même avait fini d’assembler. Et cette coïncidence, à défaut de l’étonner, lui paraît sonner à la manière d’un événement singulier. C’est comme une force mystérieuse, une sorte d’aimantation qui l’oblige à revenir sur ses pas, à se figer sur le trottoir en face du square, à écouter la mélodie brouillonne sortir de l’instrument désaccordé. Cette musique est belle à force de candeur, d’ingénuité, de maladresse appliquée et Marie-Odile revoit cette étonnante pirouette de clown alors que le jeune homme prenait livraison de son uniforme.
Une émotion s’empare d’elle, qu’elle ne saurait expliquer, et étrangement un sentiment s’installe à la manière d’une intime et troublante conviction : le destin, sous les traits de cet inconnu, est venu à sa rencontre. Ce soir, à table, alors que s’égrènent les notes enjouées d’une sonate de Diabelli, Marie-Odile est absente aux autres, à elle-même. Elle sait que quelque chose vient de changer dans sa vie. Elle en a la certitude mais elle n’en cerne pas encore les contours. Tard dans la nuit, cependant que ses parents auront regagné leurs chambres, Marie-Odile descendra sans faire de bruit dans la salle de couture. Elle feuillettera patiemment les volumes recouverts de moleskine noire. Celui de l’année 1930 portera, en date du 13 Juin, écrite en lettres fines et appliquées, l’information qu’elle vient y chercher.
13 Juin : Livraison aux Blancs Manteaux d’un ensemble
de serge grise destiné à Monsieur Milien
Gervais, pour la somme de 277 francs et 35
centimes.
30 Juin : Somme réglée par l’Econome de l’Orphelinat
des BM pour le costume de Mr MG.
IV- Canal Saint-Martin
Trois jours passèrent sans que Milien revînt jouer au Square Pasdeloup. Trois jours passèrent où Marie-Odile cousit ses surjets d’une façon aussi fantaisiste qu’illogique. Il était grand temps que l’accordéoneux fît son apparition. Le quatrième jour, aux environs de dix neuf heures, la silhouette dégingandée de Milien s’inscrivait à nouveau sur fond de Cirque d’Hiver.
Elle ne descendit pas de son étage. Elle écouta seulement les notes clinquantes sortir de l’accordéon, voltiger comme de gros bourdons au milieu des frondaisons. A la fin de l’été, une sorte d’assiduité semblait s’être emparée, par on ne sait quelle bizarrerie, du rythme de vie de Milien. Celui-ci venait, avec la régularité d’un métronome, peu avant le spectacle, disposait son pliant face à la terrasse du Glacier, le Cirque d’Hiver à sa droite. Les habitués du quartier s’étaient accoutumés à sa présence, à sa musique bancale. Chacun s’était résolu à y prêter une oreille discrète et bienveillante et il n’était pas rare que le gobelet de carton s’emplît de lumineuses pièces de dix francs.
Début Juillet, Marie-Odile estimant que la belle constance de Milien, - il regardait parfois discrètement en direction de son balcon – n’était pas le simple fait du hasard mais le fruit d’une volonté consciente (peut-être l’avait-il reconnue ?), elle se hasarda, un soir, aux alentours de dix neuf heures trente à aller flâner du côté du square. Elle s’installa à la terrasse du Glacier, regardant et écoutant à loisir le tableau simple et naïf que lui offrait Milien.
De cette époque datèrent leurs premières promenades, d’abord modestes, dans la Rue Oberkampf toute proche, puis le long du terre-plein ombragé du Boulevard Richard-Lenoir, enfin sur les berges fluviales du Canal Saint-Martin. C’était cette proximité d’un long ruban liquide glissant entre ses quais de ciment qu’ils préféraient, l’impression d’espace, la vue qui, parfois, portait loin sur le miroir de l’eau et les boules vertes des arbres comme de gros flocons entre ciel et terre. Ils parlaient peu, s’étonnaient selon les jours de l’ardeur du soleil, du courant d’air qui glissait sur la surface lisse du canal, de la rareté des passants, parfois de la foule qui, le dimanche, martelait le pavé de ses pas assidus.
C’était Marie-Odile qui s’exprimait surtout, posait des questions, faisait rebondir le dialogue. La jeune fille aurait aimé savoir ce qu’avait été la vie de Milien avant qu’elle ne le connût, l’histoire de son enfance, les raisons de sa présence à l’Orphelinat. Mais la jeune fille se heurtait à une sorte de douloureux silence qui confinait le plus souvent à la mutité. Et ce silence elle le respectait, à la façon d’un secret. Alors ils s’étonnaient de tout et de rien, du temps qui passe, de la mode, des faits divers, du spectacle de la Rue Amelot, des automobiles, de la course des Vingt quatre heures du Mans. Milien ne semblait s’intéresser qu’au divertissement, à la surface des choses, aux faits anodins d’une actualité récente. Il se passionnait pour la mise au point de la première horloge parlante, le record de vitesse de la Blue Bird sur la plage de Daytona, la propagation des ondes radio. Redescendant le canal en direction de la Rotonde de la Villette, ils restaient longtemps à observer la manœuvre du pont levant de Crimée et Milien ne se lassait jamais de regarder l’ascension du lourd tablier de métal hissé par des câbles, la rotation des immenses poulies, le jeu simultané des pignons et des crémaillères, un peu comme un enfant ébloui l’eût fait devant les aiguillages, barrières et signaux d’une voie ferrée miniature. Milien lui-même semblait être une « miniature » du genre humain que le réel n’atteindrait jamais.
Plus qu’une rencontre d’amour, la relation de Marie-Odile et de l’orphelin des Blancs Manteaux était teintée d’amitié et de respect mutuels. Marie-Odile, pour son compte, ne demandait guère plus à Milien que ce lien d’affection. Pour l’enfant qu’il était resté, Marie-Odile devait devenir, au fil des jours, la mère qu’il n’avait jamais connue.
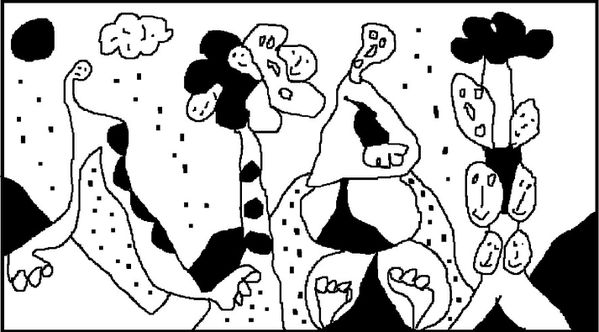
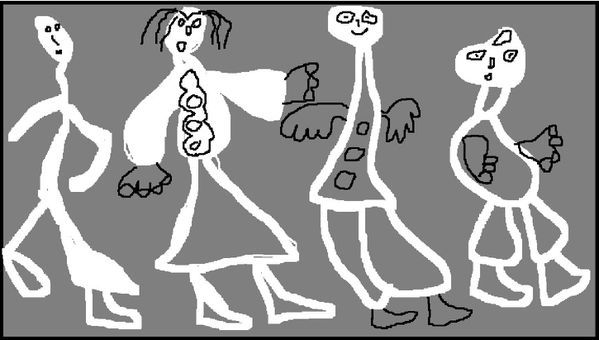


Adam Pollo : folie, mode d'emploi.
A propos de "Le Procès-verbal"
JMG Le Clézio.
(Gallimard - 1963)
Note de l'Editeur.
"Ce n'est certes pas un hasard si le héros de ce livre porte le nom insolite d'Adam Polo. Adam, c'est ici à la fois le premier et le dernier homme, celui que la folie ou l'oubli, ou encore la volonté obscure de tenter une expérience extrême, isole du reste des vivants, change en vivant survolté devant qui le monde cède à la féerie et au cauchemar.
Adam Pollo fait retraite dans une maison abandonnée, sur la colline, loin de la ville et de l'ordre incompréhensible qui s'y trame. Est-il déserteur ? Évadé d'un asile psychiatrique ? D'étranges rapports, brutaux et complices, le lient à une jeune fille, Michèle, qui semble lui servir d'indicatrice et de réplique involontaire. Mais surtout, après avoir franchi un certain état d'attention obsédée, Adam descend dans le monde, comme un prophète. Dès lors, sa vie se trouve mise en rapport avec la Vie même, animale, matérielle, inaperçue. Il devient la plage où il passe, le chien qu'il suit, le rat qu'il tue, les fauves qu'il observe dans un parc zoologique, le grand mouvement inlassable des apparences. Fabuleux itinéraire dans l'espace et la simultanéité de l'imagination qui l'amène fatalement à être arrêté et jugé par les hommes dont il a voulu, nouvel Adam infernal, transgresser les interdits : il sera donc fou, c'est-à-dire enfermé dans la région infinie des mirages rigoureux.
Par ce premier roman explosif, d'un lyrisme retenu ouvrant sur une sorte d'épopée qui évoque à la fois William Blake et les Chants deMaldoror, J. M. G. Le Clézio se révèle d'emblée un écrivain, un voyant extraordinaire.
J. M. G. Le Clézio a été reconnu d 'emblée comme un grand écrivain. « Le Procès-verbal » est son premier roman. Il a reçu le Prix Nobel de littérature en 2008."
Quatrième de couverture.
"On me reprochera certainement des quantités de choses.
D'avoir dormi là, par terre, pendant des jours ; d'avoir sali la maison, dessiné des calmars sur les murs, d'avoir joué au billard. On m'accusera d'avoir coupé des roses dans le jardin, d'avoir
bu de la bière en cassant le goulot des bouteilles contre l'appui de la fenêtre : il ne reste presque plus de peinture jaune sur le rebord en bois. J'imagine qu'il va falloir passer sous peu
devant un tribunal d'hommes ; je leur laisse ces ordures en guise de testament ; sans orgueil, j'espère qu'on me condamnera à quelque chose, afin que je paye de tout mon corps la faute de
vivre..."
Extrait.
Adam Pollo, marginal aux contours flous, après n'avoir erré qu'à l'intérieur de lui-même, gagne un jour la ville, mué en une manière de prophète venu annoncer aux hommes la survenue prochaine d'un nouveau monde. Il est arrêté et conduit à l'asile. Logé dans une pièce étroite munie de barreaux, il poursuit sa folie d'huître perlière occluse entre les quatre murs de calcaire à la vue étroite. Rien, il n'attend rien que de demeurer là où il est, dans une sorte d'hébétude matérielle :
"Mais avec de la chance, c'est pour longtemps, à présent, qu'il est fixé à ce lit, à ces murs, à ce parc, à cette harmonie de métal clair et de peinture fraîche."
(..) "La fenêtre était ouverte exactement au milieu du mur externe. Elle était garnie de barreaux qui projetaient des interférences d'ombres verticales et horizontales sur les couvertures du lit et sur le pyjama à raies. Les barreaux, au nombre de trois verticaux et de deux horizontaux, compartimentaient un ciel pareil aux murs. C'était une division arbitraire, mais cependant harmonieuse, et dont le chiffre, douze, faisait bizarrement songer aux Maisons du Ciel selon Manilius
(...) C'était clos, il était seul, unique en son genre, bien au centre. Adam écoutait lentement, sans bouger les yeux d’un centimètre ; il n’avait besoin de rien.Tous les bruits (le gargouillis d’eau dans les conduites, les coups sourds, les craquements des cossidés, les cris d’ailleurs entrant dans la chambre, coupés un à un, le murmure d’une chute de poussières voisine, quelque part sous un meuble, les légères vibrations des phagocytes, le réveil grelottant d’une paire de phalènes, à cause d’un coup plus fort porté de l’autre côté de la cloison)semblaient venir de lui-même. Au-delà des murs, il y avait d’autres pièces, toutes rectangulaires, tracées architecturalement.
Le même dessin était répété dans toutes les sections de l’immeuble, pièce, couloir, pièce, pièce, pièce, pièce, pièce, pièce, pièce, pièce, pièce,W.C., pièce, couloir, etc. Adam était content de se désolidariser comme cela, avec 4 murs, 1 verrou, et 1 lit. Dans le froid et l’illumination.C’était aisé, sinon durable. On finissait tôt ou tard par s’en douter et par l’appeler.
Dehors, dehors il faisait peut-être encore soleil ; il y avait peut-être des nuages en petits morceaux, ou bien seulement la moitié du ciel était couverte. Tout ça était le reste de la ville ; on sentait que les gens habitaient autour, en cercles concentriques, grâce aux murs ; on avait, n’est-ce pas, beaucoup de rues, en tous sens : elles découpaient les pâtés de maisons, en triangles ou en quadrilatères ; ces rues étaient pleines de voitures, de bicyclettes. Au fond, tout se répétait. On était à peu près sûr de retrouver les mêmes plans cent mètres plus loin, avec exactement le même angle de base de 35° et les magasins, les garages, les bureaux de tabac, les maroquineries. Adam élaborait mentalement son schéma : il y ajoutait bien d’autres choses. Si on prenait un angle de 48°3’, par exemple, eh bien on était certain de pouvoir le noter quelque part dans le Plan. C’était bien le diable si à Chicago il n’y avait pas une place pour cet angle ; alors, quand on le retrouverait, il suffirait de regarder le dessin pour savoir tout de suite ce qu’on avait à faire. A ce compte-là, Adam ne pouvait jamais se perdre. Le plus dur, c’était les courbes ;il ne comprenait pas comment il fallait réagir. Le mieux était d’établir un graphique ; le cercle, c’était moins compliqué : il suffisait d’en faire la quadrature (dans la mesure du possible, bien entendu) et de le décomposer en polygone : à ce moment là, il y avait des angles et on était sauvé.
( c'est moi qui souligne)
Il prolongerait, par exemple, le côté GH du polygone et il obtiendrait une droite. Ou même, en prolongeant deux côtés, GH et KL, il tomberait sur le triangle équilatéral GHz & il saurait quoi faire. Le monde, comme le pyjama d’Adam, était strié de droites, tangentes, vecteurs, polygones, rectangles, trapèzes, de toutes sortes, et le réseau était parfait ; il n’y avait pas une parcelle de terre ou de mer qui ne fût divisée très exactement, et qui ne pût être réduite à une projection, ou à un schéma.
Somme toute, il aurait suffi de partir, avec, dessiné sur une feuille de papier, un polygone d’environ 100 côtés, pour être sur n’importe quel point du globe. Si on marchait dans les rues, si on suivait sa propre inspiration vectorielle, on aurait peut-être même pu, qui le dira ? aller jusqu’en Amérique, ou en Australie. A Tchou-Tcheng, sur le Tchang, une petite maison creuse aux murs de papyrus patiente au soleil et à l’ombre, dans le bruit doux des feuilles qui se balancent, en attendant le messie-géomètre arpenteur qui viendra révéler un jour, son compas à la main, l’angle obtus qui l’écartèle. Et bien d’autres encore, au Nyassaland, en Uruguay, en plein Vercors, partout dans le monde, sur les étendues de terres sèches qui se craquellent, entre les buissons de genêts, couvertes de millions de carrés fatals comme des signes de mort,de droites crevant le ciel au bout de l’horizon avec des gestes d’éclair. Il aurait fallu aller partout. Il aurait fallu un bon plan, plus la foi ; une confiance totale dans la Géométrie Plane, et la Haine de tout ce qui est courbe, de tout ce qui ondule, pèche dans l’orgueil, le rond ou le terminal.
Dans la chambre, à ce moment-là, avec la lumière du jour qui pénétrait par la fenêtre, qui bondissait d’avant en arrière, dans tous les sens et le ceignait comme une nappe d’étincelles, avec le bruit frais et monotone des eaux, Adam se crispait davantage ; il regardait et écoutait intensément, il se sentait grandir, devenir géant ; il percevait les murs se prolongeant en droites, à l'infini, les carrés s'ajoutant les uns par-dessus les autres, toujours plus grands, toujours un petit peu plus grands ; et peu à peu la terre entière était recouverte de ce gribouillis, les lignes et les plans se croisaient en claquant comme des coups de feu, marqués à leurs intersections par de grosses étincelles qui retombaient en boules, et lui, Adam Pollo, Adam P..., Adam, point séparé du clan des Pollo, était au centre, absolument au cœur, avec le dessin tout tracé, tout prêt pour qu’il puisse prendre la route, et marcher, aller d’angle en angle, de segment en vecteur, et dénominer les droites en gravant de l’index leurs lettres dans le sol : xx’, yy’, zz’, aa’, etc."
En guise de commentaire.
En 1963, lorsque fut publié "Le procès-verbal", le livre fit irruption dans le champ littéraire d'une façon toute singulière. L'étonnement suscité, s'il pouvait avoir pour fondement l'originalité de la fiction, n'en était pas moins lié à la qualité particulière du langage convoqué afin de servir le projet de l'œuvre. Le titre de "procès-verbal", s'il peut faire signe vers une manière de "compte-rendu" , de "rapport" sur une expérience de vie, à savoir une existence marginale, ne saurait se limiter à une simple collation d'événements, fussent-ils hors du commun. Dans le titre, ce qu'il est nécessaire d'entendre, c'est bien plutôt la dimension d'une volonté assignée à faire "le procès du verbe" en l'extrayant de sa gangue signifiante habituelle. Ce roman, comme un certain nombre d'entreprises ultérieures de Le Clézio, est une construction langagière intellectuelle. C'est du dedans du langage, de sa structure même, qu'il faut envisager l'univers qui est proposé au lecteur.
Le sujet situé à l'épicentre du "Procès" est celui de la folie. Or la folie n'est jamais accessible de l'extérieur qu'à titre d'observation expérimentale, c'est à dire, comme objet. La comprendre, c'est en une certaine manière, se l'approprier, se glisser dans la peau du dément, vivre ses gestes, ses manies, sa solitude, se glisser dans sa conscience forclose. Devenir sujet.
Le langage sera le véhicule qui assurera cette nécessaire conversion. On sera d'emblée plongé dans la constellation schizophrénique, entouré d'étincelles et de feux de Bengale, de phrases étranges comme des comètes, de brusques fulgurations, de suites de mots incohérents, de chutes, de soudaines résurgences, on sera cloué à un vocabulaire zoomorphe avec des déplacements annelés, des trépidations de cloporte, tellement semblables aux convulsions des "Chants de Maldoror", à ses processus de dilution où le délire gire infiniment autour de sa propre frénésie.
A cette fin d'insignifiance, d'incommunicabilité ou bien, parfois, leur contraire, le débondement verbal infini, seront convoqués aussi bien des créations poétiques baroques et surréalistes, des listes diverses, des coupures de journaux, des lambeaux d'affiche, des phrases biffées. Identiquement à Lautréamont qui employait les ressources de son génie "à peindre les délices de la cruauté.", l'écrivain a bien compris qu'on ne peut rester extérieur à la maladie mentale, à ses ravages, à ses excès comme à ses retraits, ses étonnants revirements. Il faut se métamorphoser en prédateur, il faut devenir hyène, marcher de guingois, l'arrière-train émacié, les oreilles courtes, le museau hérissé de crocs mortifères et débusquer les cadavres qui parsèment la savane de leurs odeurs pestilentielles, sucer l'os jusqu'à la moelle, racler le moindre mot, en extraire la souffrance urticante, en presser le jus psychotique, la fibre aliénée. Dès lors se comprend mieux le saisissement du lecteur, son vertige, parfois sa difficulté à pénétrer l'œuvre. Ici, l'histoire n'est pas une fin en soi, elle n'est que le fil rouge qui court tout au long d'un périlleux voyage. On a quitté les rives rassurantes de la conscience ordinaire pour s'immerger dans l'invisible, l'indicible. On a à faire face à la "vérité" du fou, à son immersion racinaire, rhizomatique dans l'humus où plus rien ne fait sens, dans le sol primitif où grouillent des entités thériomorphes.
1963 - Plusieurs critiques, alors soumis à l'urgence d'étiqueter la nouveauté, de lui attribuer un sceau rassurant, l'avaient situé dans la perspective du "Nouveau roman". Or, si les recherches formalistes pouvaient s'en rapprocher, interrogation sur l'acte d'écrire, personnages au second plan, intérêt pour les objets et leur description, il semblait qu'en même temps s'installait une sorte de nouveau paradigme permettant l'accès à une littérature différente. Au début de l'œuvre, la recherche d'un langage renouvelé, d'une écriture forant la peau du réel, traversant le miroir des apparences, s'instillant à même le corps des choses, pénétrant leur chair vive; tentative à proprement parler rimbaldienne, mallarméenne, projection spermatique, de lymphe, de sang, turgescence du dire, coruscation ultime des mots.
"Un jour le langage sortira de ses camps...Il sera libre...Des mots pareils aux crochets du naja, se dresseront et entreront dans la chair."
(Les Géants - 308)
Autour de Le Clézio des noms s'écrivaient : Nathalie Sarraute; Michel Butor; Georges Pérec. On évoquait aussi, à juste titre, Camus en raison d'une résonance existentialiste et Henry Miller pour sa tentative de description de son propre univers chaotique, désespéré, surplombé par l'inévitable déréliction.
Mais, pour pénétrer au plus près la nature du "Procès", pour en percevoir l'essence, il faudra s'installer sur des rives escarpées à partir desquelles donner acte et espace à la folie, à sa confondante concrétion. Et d'abord regarder au plus près la nature du réel. En faire une lecture "archaïque", parménidienne, c'est à dire porter sur les choses une vue pleine et circulaire dont l'être, à chacune de ses manifestations, nous assure, que nous destinions notre regard à la plénitude du paysage, la courbe de l'horizon, que nous nous appliquions à faire émerger l'épiphanie d'un visage, le contenu d'une œuvre d'art, l'espace domestique rassemblé autour du foyer, le dôme infini du ciel où courent les étoiles, les constellations et les planètes, tous corps dont les "Maisons du ciel selon Manilius" nous font également l'offrande.
Or, il y a une harmonie, une manière de sérénité découlant de notre observation du monde. Celui-ci en sa positivité, son évidence, sa pleine densité, reflète simplement l'ordre cosmique, lequel s'oppose au chaos originel. Garder cette sphère intacte nous assure toujours de ne pas chuter hors d'elle dans le non-être, autrement dit, le non-sens.
Jamais la ligne, ouverte, illimitée, ne saurait accéder à l'être. Ceci, du moins, était-il impensable chez les disciples de Parménide.
Or, Adam, dans son entreprise de nier cette réalité qui l'oppresse et le place hors de la société, fait le choix d'une éviction de cette sphère primitive chère à certains présocratiques. Plongeant délibérément dans la folie, en faisant son seul lexique existentiel, il se soustrait à tout ce qui, courbe, sphère, anneau, pourrait contribuer à l'installer dans la normalité, la raison :
"Le plus dur, c’était les courbes; il ne comprenait pas comment il fallait réagir. Le mieux était d’établir un graphique ; le cercle, c’était moins compliqué : il suffisait d’en faire la quadrature (dans la mesure du possible, bien entendu) et de le décomposer en polygone : à ce moment là, il y avait des angles et on était sauvé."
Les angles, les polygones, voilà ce qu'il faut introduire dans la parfaite figure circulaire afin "d'être sauvé" de l'effrayante normalité, afin que la différence s'installe, que le museau aigu de la schizophrénie puisse faire céder la bogue, la déchirer, l'écarteler sous les coups de boutoir de l'irraisonné, l'insensé, l'incompréhensible :
" (...) la Haine de tout ce qui est courbe, de tout ce qui ondule, pèche dans l’orgueil, le rond ou le terminal."
La seule figure désormais possible n'est plus la forme rassurante et parfaite de la sphère, se suffisant à elle-même, impliquant une finitude dans l'espace, donc une clôture de tout ce qui est; indivisible, inatteignable, non accessible aux contorsions et mouvances de l'apparence sensible, réservoir d'illusions infinies. La seule figure est celle d'une géométrisation poussée à son acmé, d'une abstraction qui ne pourra rien dire d'elle-même, sinon sa vacuité, figure inexistentielle, sans aspérité où pourrait s'accrocher quelque langage ouvrant un monde.
Droites, droites, droites, lignes, lignes, lignes et ainsi jusqu'à l'extrême limite où les choses basculent :
"Le monde, comme le pyjama d’Adam, était strié de droites, il percevait les murs se prolongeant en droites (...) et peu à peu la terre entière était recouverte de ce gribouillis, les lignes et les plans se croisaient en claquant comme des coups de feu (...)
Les conditions de la folie sont désormais atteintes. Maintenant peut s'ouvrir la gueule béante par où s'extraire de la multitude, afin de fuir le plus loin possible de la civilisation, de l'homme, et abandonner ainsi toute prétention à la certitude de vivre.
De la sphère à la ligne, Adam Pollo procède à une annulation de sa propre identité. Il accomplit en sens inverse le parcours spéculaire lacanien par lequel le tout jeune enfant, voyant sa propre image reflétée dans le miroir globalisant et synthétisant, réalise "l'assomption jubilatoire" qui le pourvoit d'un corps unitaire définitivement à l'abri du morcellement primitif dont, jusqu'alors, il était affecté.
C'est de cette fragmentation même , de cette dislocation dont Adam était porteur depuis l'origine et qu'il voulait, consciemment ou à son insu, mettre à jour. Son douloureux cheminement regarde étrangement en direction de l'expérience mescalinienne dont Henri Michaux a été l'un des plus lucides représentants. Nul doute que Le Clézio, critique de l'auteur (voir son essai "Vers les icebergs" - 1978) n'ait été, en une certaine manière, influencé par cette littérature au confluent de la création, de ses limites, là où pourrait se tutoyer la folie. Certains textes de Le Clézio et de Michaux pourraient presque se superposer dans une manière d'osmose, lucidités infiniment ouvertes à la compréhension du désarroi de l'homme, laquelle fait aussi toute la beauté de sa dimension tragique.
Dans le chapitre intitulé "Expérience de la folie" ("Misérable miracle" - 1972), Michaux découvre avec une stupeur teintée de ravissement, le peuple des lignes mescaliniennes :
"Les vagues de l'océan mescalinien avaient fondu sur moi, me bousculant, me culbutant comme menu gravier. Les mouvements, jusque là dans ma vision, étaient maintenant SUR moi (c'est Michaux qui souligne) . (...) J'étais perdu. (...) Des lignes, de plus en plus de lignes (...) De grands Z passent en moi (zébrures-vibrations-zigzags ?) . Puis ce sont des S brisés (...) Anesthésié au monde jouisseur de mon corps (...) Devenu proue (...) Les lignes se suivent presque sans arrêt. (...) Et les lignes, les lignes d'écartèlement (...) Ce fut une plongée instantanée (...) et soudain les vagues de l'océan mescalinien qui débouchaient sur moi me renversaient. Me renversaient, me renversaient, me renversaient, me renversaient, me renversaient. (...) J'étais seul dans la vibration du ravage, sans périphérie, sans annexe, homme-cible qui n'arrive plus à rentrer dans ses bureaux."
Etrange entrecroisement de destins qui, dans des expériences différentes, (l'isolement du monde pour Adam, la prise d'une drogue pourMichaux) se rejoignent, confluent, parviennent sur les mêmes rivages cernés de lignes convulsives, zébrées, destructrices de la raison. Soudain, la folie, pour Adam-Michaux, possède un visage, mais un visage abstrait, privé de paroles, sorte de mime grimaçant portant avec lui le souffle blême du néant, les nervures aigües du rien. La sphère archaïque irisée comme une bulle s'est métamorphosée en un échinidé aux piquants venimeux. Et l'homme de raison, de sentiment, de sensations s'est empalé sur ces pieux mortifères.
Car si la philo-cosmologie parménidienne peut prêter à sourire aujourd'hui, eu égard à son innocence puérile, elle n'en demeure pas moins dans la conscience archétypale, une manière de sein nourricier, de conque primitive où s'assurer d'un futur essor. A trop vouloir rationnaliser, alors que la sphère présocratique reposait sur le pivot de la raison, les hommes se sont évincés eux-mêmes de l'abri qui les nourrissait. Or, jamais l'enfant, l'adulte, ne s'abstraient totalement de cette enveloppe symbolique qui constitue leur armature originelle. Toujours, au-dessus de leur fontanelle existentielle, elle prolonge la demeure amniotique. L'eau est un aliment nécessaire à l'existence fût-elle fantasmée. La laisser se tarir, c'est accepter d'entrer en rébellion contre soi-même au risque de la folie.
Le Clézio y échappe en convoquant Adam Pollo dans un procès du verbe, alors que Michaux s'en extrait à la mesure de ses dessins mescaliniens. Ainsi, la création, apparaît-elle cette écriture par laquelle exorciser bien des démons. Le lecteur, quant à lui, aura été schizophrène par défaut, le temps d'un procès qu'on aura instruit pour lui, l'espace de vagues mescaliniennes entamant déjà leur reflux de papier.
/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)