Cirque d'Hiver

Source : Structurae.
Avant-Texte
Marie-Odile vit
à Paris, Boulevard du Temple, entre son père Henri, tailleur de
son état et sa mère Marguerite, bénévole auprès des enfants
malades à l’Hôpital Saint-Louis.
Milien, un accordéoneux orphelin recueilli par les Sœurs des Blancs Manteaux, vient jouer quotidiennement devant le Cirque d’Hiver.
Un jour, Marie-Odile et Milien décident d’unir leurs vies sous le signe de l’amitié.
Mais Henri est fortement opposé à cette union qu’il juge contre nature. Le couple quitte Paris et se réfugie dans le sud, à Callonges où
vit Gary Mengès, un oncle de Marie-Odile.
Celle-ci est occupée à des travaux de couture alors que Milien vit dans
un songe permanent au milieu des airs et fredaines du music-hall.
Puis, un jour, après la disparition de Gary, tout bascule et la Combe Gignac où ils vivent devient le lieu d’un
non-sens.
Pour des raisons liées à leur propre passé, l’accomplissement de leurs destins ne pouvait exister que
sous la forme du tragique.
***********************
I - Boulevard du Temple
Paris. Automne 1920
Septembre a habillé Paris d’une teinte fauve, couleur d’écorce. Quelques feuilles
se détachent déjà des arbres, jonchant les trottoirs d’étoiles lumineuses. Du haut de sa fenêtre, Marie-Odile
regarde les allées et venues boulevard du Temple. Ce sera bientôt l’heure de la projection au Cirque d’Hiver et les globes électriques se sont
allumés. Les premières voitures, longues carrosseries noires et jaunes que coiffe une capote de toile huilée, se rangent le long de la Rue Amelot. De minces jeunes femmes en descendent, vêtues à la
garçonne, tailleurs-jupes, chemises blanches à cols et manchettes, cheveux courts plaqués par un bandeau. Marie-Odile aimerait bien aller s’asseoir sur les sièges de velours, attendre que les lampes s’éteignent et regarder les images envahir l’écran à la façon d’un
rêve.
Mais Marie-Odile n’a
que huit ans. « Tu n’as pas l’âge du
cinéma », lui dit toujours son père et elle se contente du spectacle de la rue, laisse sa vue planer sur les
frondaisons de la Place Pasdeloup, du petit square entouré de grilles où l’on promène des enfants dans de grands landaus noirs. Alors, de dépit ou par désœuvrement, elle se laisse glisser dans le
grand escalier ciré qui descend les étages. Une lumière dorée coule dans la salle à manger, faisant briller les maroquins des livres. Sur la grande table ovale, deux ou trois volumes que sa mère
a dû consulter avant de partir faire la lecture aux enfants de l’hôpital.
Au rez-de-chaussée, sous le rond d’une opaline verte, son père est occupé à tailler un
costume.Marie-Odile aime l’odeur mouillée de la pièce, les carrés de moleskine et de satin pareils aux damiers d’un paysage, les grands ciseaux qui déchirent la toile en
crissant, la légèreté des papiers de soie, les calques semblables à des voiles de brume, la machine à coudre et son pédalier de fer, le hérisson d’aiguilles accroché à la manche d’Henri, le mètre jaune et noir comme une longue chenille autour de son
cou. Marie-Odile passe des heures à l’atelier, lorsqu’elle n’a pas école, apprenant à découper un patron, à en reporter le modèle sur la toile, à coudre des doublures, à
s’essayer aux épaulettes, au repassage avec l’odeur âcre de la pattemouille et les vapeurs qui piquent les yeux.
Ce qu’elle aime aussi c’est aller au Sentier, sous la verrière blanche des grands entrepôts et fouiller
parmi les empilements de coupons, éprouver la souplesse des jerseys, la douceur des cachemires, le friselis du crêpe, la glaçure de la soie pareille au flanc d’un céladon. Quand elle a
épuisé le plaisir de l’atelier, elle remonte à la cuisine, met le couvert, attendant que sa mère soit rentrée de l’hôpital, que son père ait fini de faufiler un pantalon, un gilet. Puis le repas
en silence avec un peu de musique en toile de fond. On a si peu à dire alors que la vie coule à la façon d’une eau paisible. Avant de s’endormir, Marie-Odile, derrière le cadre de sa fenêtre, regarde les feuilles du square glisser sur le
bitume. Les derniers spectateurs quittent le Cirque d’Hiver. Une brume légère grise les trottoirs. Il est temps alors de tirer les rideaux. Henri a rejoint
son atelier pour finir d’y tailler un lin, une flanelle. Marguerite, sur le sofa, lit les histoires qu’elle racontera demain aux enfants. Les jours succèdent aux jours, géométrie simple et ordonnée que délimitent le
Cirque d’Hiver, le Sentier, la Rue Amelot, la Rue Bichat près de Saint-Louis.
II - Les Blancs Manteaux
Paris. Eté 1930
Dans ses cheveux relevés en
chignon, Marie-Odile plante une écaille blanche, se maquille discrètement - une touche de poudre de riz -, regarde la pluie qui glisse doucement le long des vitres. Une grande
flaque grise, Place Pasdeloup, dans laquelle se reflètent le dôme sombre du Cirque d’Hiver, les statues équestres qui en encadrent la porte. Sur la planche à tréteaux, un carton avec un costume
de serge grise. Calligraphiée sur une étiquette, l’écriture d’Henri :
Monsieur Milien
GERVAIS
Institut des Blancs
Manteaux
Rue de
Bretagne
Boulevard du Temple le ciel s’est un
peu éclairci, couleur d’ardoise avec de longues traînées blanches. Sous son parapluie, Marie-Odile regarde les nuages semblables à la toile qu’elle porte aux Blancs Manteaux. Elle
se souvient y être allée alors qu’elle était adolescente. Arrivée Rue de Bretagne elle reconnaît, face au Square du Temple, un immeuble de pierre aux grandes verrières, la façade ornée de fleurs
de lys. Elle sonne, pénètre sous le porche. Une Religieuse vêtue de blanc sort de la loge. Marie-Odile lui
remet le carton qu’elle a pris soin d’envelopper dans une pièce de coton épais mais la pluie a délavé la belle écriture d’Henri et le nom
est tout juste lisible.
La Sœur prend le colis, ajuste ses lunettes. Elle va au pied de l’escalier où coule une lumière verte d’aquarium. Elle appelle :
« Monsieur Milien, il y a une surprise pour vous, descendez
vite ! ».
Un bruit de pas sur les marches. Un homme jeune, l’air un peu égaré, un soupçon de moustache sur la lèvre
supérieure ; de grandes lunettes cerclent des yeux effarouchés. Il s’empare du costume de serge, bredouille quelques mots incompréhensibles, se retire avec une sorte de révérence maladroite.
La Sœur remercie. Marie-Odile prend congé. A sa droite, sur une plaque qui brille discrètement dans la
pénombre, une inscription que les années ont presque effacée :
Orphelinat des
Blancs Manteaux
La porte s’ouvre sur des trottoirs qui
étincellent. Le soleil d’été est revenu. Rue des Filles du Calvaire la boulangerie est encore ouverte. Marie-Odile y
achète un pain de campagne, couleur de moisson, à la croûte ferme et odorante. Dans la perspective de la rue elle aperçoit les murs arrondis du Cirque d’Hiver, ses grilles de fer forgé, ses
lanternes de bronze. Elle ne sait pourquoi, elle repense à ce grand dadais des Blancs Manteaux. La serge grise lui ira bien ; il paraît si sérieux avec ses immenses lunettes, son air de
séminariste. Elle entre dans la maison. On entend le cliquetis des ciseaux dans l’atelier. A l’étage, les variations Goldberg de Bach. La journée a dû couler comme du miel à l’hôpital
Saint-Louis. Il sera bientôt l’heure de dîner.
III- L’Accordéoneux
Paris. Eté 1932
Dans sa
chambre Marie-Odile pique les poches d’un gilet, met un dernier point à une boutonnière. Puis elle se lève, ouvre la fenêtre. Les platanes, sur le boulevard, font une longue
coulée verte pareille à un nuage d’eau. Quelques enfants, dans le square, jouent à se poursuivre autour de la fontaine au pélican ; des femmes en ombrelles sortent de la bouche du métro. Au
café Glacier, à l’angle de la Rue Amelot, les tables se remplissent peu à peu. Derrière les murs du Cirque d’Hiver on brosse les alezans, les écuyères s’habillent de tulle, les jongleurs font
tourner leurs massues. Dans un peu moins d’une heure les portes s’ouvriront sous l’éclat des projecteurs, l’orchestre enverra ses premières notes de musique.
Dehors aussi, dans l’air qui se teinte de mauve, l’éclat de quelques notes, les plaintes d’un
accordéon dont on joue gauchement, sorte de pot-pourri de musette et de rengaines de music-hall. Dans la rue les regards se tournent et découvrent, tout près du square, le musicien assis sur un
pliant de toile, un gobelet de carton à ses pieds. Du haut de son balcon, Marie-Odile a aussitôt été attirée par cette ritournelle étrange, jouée avec l’innocence d’un
enfant. Elle regarde un moment ce spectacle improvisé. Quelques bambins jettent un peu de monnaie dans la sébile et ça fait un bruit semblable à la pluie sur un toit de tôle. L’homme est
d’apparence jeune, plutôt fluet, ses yeux dissimulés derrière des lunettes à monture d’ébonite, cintré dans un costume gris, de grandes chaussures de cuir à ses pieds. Ses mains longues et fines
glissent sur les boutons de nacre, hésitantes comme les premiers pas d’un funambule.
Marie-Odile referme la fenêtre, descend les marches de bois. Au rez-de-chaussée son père repasse des toiles dans un air embrumé de vapeur. Elle décide d’aller faire
quelques pas en direction de Filles du Calvaire, pour dégourdir ses jambes, s’aérer, profiter des derniers rayons du soleil qui remontent le boulevard depuis la Bastille dans une sorte de nuage
doré. Alors, dans son esprit, c’est une brusque illumination, comme si, l’espace de quelques secondes, le temps s’était inversé, qu’il avait reflué jusqu’à ce jour gris et pluvieux où elle était
allée, Rue de Bretagne, faire sa livraison. Elle revoit, dans le jour glauque de l’entrée des Blancs Manteaux, la Religieuse dans ses voiles clairs, la silhouette évanescente du Pensionnaire venu
récupérer son deux pièces de serge grise. Mais oui, l’évidence est là, l’accordéoneux du Cirque d’Hiver n’est autre que l’orphelin à qui elle a livré, il y a deux ans, le costume taillé par son
père, qu’elle-même avait fini d’assembler. Et cette coïncidence, à défaut de l’étonner, lui paraît sonner à la manière d’un événement singulier. C’est comme une force mystérieuse, une sorte
d’aimantation qui l’oblige à revenir sur ses pas, à se figer sur le trottoir en face du square, à écouter la mélodie brouillonne sortir de l’instrument désaccordé. Cette musique est belle à force
de candeur, d’ingénuité, de maladresse appliquée et Marie-Odile revoit cette étonnante pirouette de clown alors que le jeune homme prenait
livraison de son uniforme.
Une émotion s’empare d’elle, qu’elle ne saurait expliquer, et étrangement un sentiment s’installe à la
manière d’une intime et troublante conviction : le destin, sous les traits de cet inconnu, est venu à sa rencontre. Ce soir, à table, alors que s’égrènent les notes enjouées d’une sonate de
Diabelli, Marie-Odile est absente aux autres, à elle-même. Elle sait que quelque chose vient de changer dans sa vie. Elle en a la certitude mais elle n’en cerne pas encore les
contours. Tard dans la nuit, cependant que ses parents auront regagné leurs chambres, Marie-Odile descendra sans faire de bruit dans la salle de couture. Elle feuillettera patiemment les volumes recouverts de moleskine noire. Celui de l’année
1930 portera, en date du 13 Juin, écrite en lettres fines et appliquées, l’information qu’elle vient y chercher.
13 Juin : Livraison aux Blancs Manteaux d’un ensemble
de serge grise destiné à Monsieur Milien
Gervais, pour la somme de 277 francs et 35
centimes.
30 Juin : Somme réglée par l’Econome de l’Orphelinat
des BM pour le costume de Mr MG.
IV- Canal Saint-Martin
Trois jours passèrent sans
que Milien revînt jouer au Square Pasdeloup. Trois jours passèrent oùMarie-Odile cousit ses surjets d’une façon aussi fantaisiste qu’illogique. Il était grand
temps que l’accordéoneux fît son apparition. Le quatrième jour, aux environs de dix neuf heures, la silhouette dégingandée de Milien s’inscrivait à nouveau sur fond de Cirque d’Hiver.
Elle ne descendit pas de son étage. Elle écouta seulement les notes clinquantes sortir de l’accordéon,
voltiger comme de gros bourdons au milieu des frondaisons. A la fin de l’été, une sorte d’assiduité semblait s’être emparée, par on ne sait quelle bizarrerie, du rythme de vie deMilien. Celui-ci venait, avec la régularité d’un métronome, peu avant le spectacle, disposait
son pliant face à la terrasse du Glacier, le Cirque d’Hiver à sa droite. Les habitués du quartier s’étaient accoutumés à sa présence, à sa musique bancale. Chacun s’était résolu à y prêter une
oreille discrète et bienveillante et il n’était pas rare que le gobelet de carton s’emplît de lumineuses pièces de dix francs.
Début Juillet, Marie-Odile estimant que la belle constance de Milien, - il regardait parfois discrètement en direction de son balcon – n’était pas le simple fait du hasard mais le fruit d’une volonté consciente (peut-être
l’avait-il reconnue ?), elle se hasarda, un soir, aux alentours de dix neuf heures trente à aller flâner du côté du square. Elle s’installa à la terrasse du Glacier, regardant et écoutant à
loisir le tableau simple et naïf que lui offrait Milien.
De cette époque datèrent leurs premières promenades, d’abord modestes, dans la Rue Oberkampf toute proche, puis
le long du terre-plein ombragé du Boulevard Richard-Lenoir, enfin sur les berges fluviales du Canal Saint-Martin. C’était cette proximité d’un long ruban liquide glissant entre ses quais de
ciment qu’ils préféraient, l’impression d’espace, la vue qui, parfois, portait loin sur le miroir de l’eau et les boules vertes des arbres comme de gros flocons entre ciel et terre. Ils parlaient
peu, s’étonnaient selon les jours de l’ardeur du soleil, du courant d’air qui glissait sur la surface lisse du canal, de la rareté des passants, parfois de la foule qui, le dimanche, martelait le
pavé de ses pas assidus.
C’était Marie-Odile qui
s’exprimait surtout, posait des questions, faisait rebondir le dialogue. La jeune fille aurait aimé savoir ce qu’avait été la vie de Milien avant
qu’elle ne le connût, l’histoire de son enfance, les raisons de sa présence à l’Orphelinat. Mais la jeune fille se heurtait à une sorte de douloureux silence qui confinait le plus souvent à la
mutité. Et ce silence elle le respectait, à la façon d’un secret. Alors ils s’étonnaient de tout et de rien, du temps qui passe, de la mode, des faits divers, du spectacle de la Rue Amelot, des
automobiles, de la course des Vingt quatre heures du Mans. Milien ne semblait s’intéresser qu’au divertissement, à la surface des choses, aux faits
anodins d’une actualité récente. Il se passionnait pour la mise au point de la première horloge parlante, le record de vitesse de la Blue Bird sur la plage de Daytona, la propagation des ondes
radio. Redescendant le canal en direction de la Rotonde de la Villette, ils restaient longtemps à observer la manœuvre du pont levant de Crimée et Milien ne se
lassait jamais de regarder l’ascension du lourd tablier de métal hissé par des câbles, la rotation des immenses poulies, le jeu simultané des pignons et des crémaillères, un peu comme un enfant
ébloui l’eût fait devant les aiguillages, barrières et signaux d’une voie ferrée miniature. Milien lui-même semblait être une « miniature » du genre humain que le réel n’atteindrait jamais.
Plus qu’une rencontre d’amour, la relation de Marie-Odile et
de l’orphelin des Blancs Manteaux était teintée d’amitié et de respect mutuels. Marie-Odile, pour son compte, ne demandait guère plus à Milien que ce lien d’affection. Pour l’enfant qu’il était
resté, Marie-Odile devait devenir, au fil des jours, la mère qu’il n’avait jamais connue.
V- Jour de relâche
Paris. Automne-hiver
1933
Ainsi le temps passait dans
une manière de paisible harmonie, faisant alterner la douceur des tissus de soie, les notes syncopées du Square Pasdeloup, les longues promenades sur les rives du Canal Saint-Martin. Pris dans
les mailles des jours, Milien et Marie-Odile se
laissaient aller à une mélancolie facile que le réel n’atteignait guère. L’automne finissant paraît leur rencontre des couleurs lentes de l’insouciance. Cependant le chemin qu’ils empruntaient,
aussi droit et lumineux que le fil de l’horizon, devait s’assombrir de quelques nuées et bientôt l’atmosphère bascula de la douceur d’octobre aux rigueurs de novembre.
Milien, fidèle à sa mission d’accordéoneux, venait se disposer face au Glacier, vêtu d’un long manteau de poils qui tutoyait le trottoir de ciment. Les
consommateurs n’étaient plus aux terrasses mais dans des rotondes que chauffaient des poêles à pétrole. Les jeux des enfants se faisaient plus rares autour de la fontaine au pélican. Quant
à Henri, son mètre ruban autour du cou, il surveillait avec
anxiété et amertume, depuis son atelier, le manège de Marie-Odile et de son musicien. Il considérait la situation sans issue et s’en ouvrit, un
soir, à sa fille avec une sorte de violence à laquelle elle ne s’attendait guère :
« Marie-Odile, l’accordéoneux, ça suffit. Tu choisis, c’est nous
ou c’est lui ! »
Le message, bien qu’elliptique, était sans équivoque et ne semblait tolérer aucune
issue. Marie-Odile ne s’en offusqua pas. Elle pardonnait à son père ce tempérament entier qui, en fait, cachait une profonde humanité. Elle monta dans sa chambre et
parcourut du regard le désordre des toiles et des tissus que, depuis plusieurs jours, elle se préparait à assembler. Elle ouvrit l’armoire, y prit quelques effets, des affaires de toilette, une
sacoche de cuir offerte par sa mère pour son dernier anniversaire. Quelque part, dans la rue, un violoneux distillait les notes tristes de l’adagio d’Albinoni. Elle tira les rideaux. La bise
faisait tourbillonner les dernières feuilles des platanes qui voltigeaient comme d’inutiles papillons. C’était jour de relâche au Cirque d’Hiver.Milien ne
viendrait pas.
Gary Mengès
Fin Novembre, la lettre
que Marie-Odile attendait est enfin arrivée. Elle est montée dans sa chambre, a ouvert l’enveloppe. L’écriture souple de son oncle Gary courait le
long des pages.
Callonges, Jeudi 23 Novembre 33
Ma chère Marie-Odile,
Ta
lettre m’a fait le plus grand plaisir malgré les nouvelles en demi-teintes que tu m’annonces. Ainsi mon beau-frère Henri t’a mise devant un choix pour le moins délicat : ou bien rester Boulevard du Temple ou plaquer ton accordéoneux. Et ma
sœur Marguerite, comment réagit-elle ? Tu ne m’en
parles pas. Bien sûr il ne m’est guère aisé de prendre position et je ne voudrais pas déclencher une inutile polémique, les choses ne semblant pas aller de soi.
En
attendant que les esprits se calment, nous pourrions envisager une nécessaire période de transition. Tu viendrais quelque temps habiter à Callonges avec Milien. Je pourrais te confier des travaux de couture, finitions, retouches.
Heureusement le travail ne manque pas dans cette ville où les tailleurs ne semblent guère vouloir élire domicile. Milien pourrait trouver facilement des petits travaux à effectuer. J’ai quelques relations parmi ma clientèle et je ne doute pas que nous puissions lui
dégoter une activité à son goût.
En ce
qui concerne le logement, j’ai toujours ma maison de la Combe Gignac, tu sais cette vieille bicoque au toit d’ardoises qu’enfant tu nommais « La Maison Perdue », à juste titre d’ailleurs, elle est si loin de tout.
Mon ami Ségala, le peintre, y passera un coup de badigeon et je vous ferai livrer quelques stères de bois pour la cheminée. J’ai aussi un vieux Godin que vous pourrez installer dans la salle à
manger. Et puis, quand on est jeune, on n’a jamais froid !
Vous
aurez de quoi vivre à votre aise et quand ton père Henri sera revenu à la raison, tu pourras rejoindre le Boulevard du
Temple auquel tu es tant attachée et Milien se mettra à nouveau à jouer du piano à bretelles pour les Belles du
Cirque d’Hiver. Console-toi donc. Il n’y a que le temps qui soit irrémédiable. Les pires situations ont toujours une issue. Ma petite Mario, j’attends de tes nouvelles et m’impatiente à l’idée de te retrouver bientôt,
ainsi que « ton » Milien.
Affectueusement,
Ton
Oncle Gary.
PS : Je ne sais pas quel
temps il fait à Paris. Ici c’est l’été indien. Dans la rue les hommes sont en chemise et les terrasses de café ne désemplissent pas. Puisse ce temps béni durer jusqu’à Noël !
Le voyage
En ce jour de Noël les rues
de Paris sont étrangement vides, comme si Montmartre s’était transformé en Vésuve, projetant sur la ville une nuée de cendres. Marguerite et Henri sont au salon, occupés à des réussites. Marie-Odile, sac de cuir à la main, descend le grand escalier, se gardant de faire grincer
les marches. Elle souhaite quitter la maison à la manière d’une ombre, évitant les remous, les reproches, les regards qui jugent, les réflexions qui fouillent jusqu’au centre du
corps.
Sur sa table de travail, au milieu des piles de tissus, elle a laissé, bien en évidence, la lettre de
Gary que ne manqueront pas de lire ses parents après qu’elle sera partie. Ainsi il n’y aura aucun mystère, aucune équivoque et Marie-Odile n’aura pas à se justifier, à se lancer dans de vaines explications. Marguerite ne
s’étonnera le moins du monde de la main secourable offerte par son frère. Quant à son père, il perdra une « petite
main » mais retrouvera une sérénité à
laquelle il aspire. Sans doute ne comprendra-t-il pas cette tocade de Marie-Odile pour cet orphelin qu’elle connaît à peine. Du reste il manifeste une hostilité
instinctive face aux saltimbanques, camelots, et bateleurs qui singent la vie plutôt que de la vivre.
La rue est nappée de gris, entourée des falaises blanches des immeubles. Quelques feuilles flottent
comme des étoiles mortes que le vent bouscule. Devant les Blancs Manteaux, dans le renfoncement de la porte cochère, une silhouette noire, un sac de toile à la
main. Marie-Odile craignait, jusqu’au dernier moment, une
incompréhension de la consigne, une subite volte-face, peut être un simple caprice d’enfant. Mais non, Milien est bien
là à l’attendre. Mais en perçoit-il seulement le sens ?
Les deux fugitifs remontent la Rue Réaumur, disparaissent dans la bouche de métro à Arts et métiers. De
la nappe immobile du ciel tombe un lent grésil. A la gare d’Austerlitz les voyageurs sont peu nombreux. Pendant la durée du trajet, comme au bord du Canal Saint-Martin, c’est Marie-Odile qui
entretient les braises de la conversation. Souvent Milien, la
tête appuyée contre le coussin, s’endort en souriant, poursuivant on ne sait quel rêve d’enfant. Il fait presque nuit lorsque le train arrive à Callonges. Sur le quai, drapé dans un élégant loden
vert bouteille, coiffé d’un chapeau marron à larges rebords, Gary Mengès attend ses invités. Ce soir des couverts sont retenus
à La Table d’Epicure, dans le quartier de la vieille ville.
VI - La chute
Callonges. Automne 1980
Début octobre et déjà les premières morsures du froid. Venu des plaines, le vent glisse le long des
berges du Dol, remonte la pente de Tertre Rouge, balaie les immeubles de béton, s’engouffre dans le goulet de la Combe Gignac puis ressort entre les lèvres blanches du causse en de longs
tourbillons qui font voler les feuilles. Sur son lit, dans « La Maison Perdue », Marie-Odile ne dort pas. Les idées courent dans sa tête avec la même obstination que le
noroît sur le granit usé. Entre deux accalmies elle entend, au fond de la pièce, le souffle rauque et irrégulier de Milien, ses rêves à voix haute, parfois ses délires qui ressemblent aux cris aigus des
corneilles, à la course des rats dans les combles remplis de ténèbres.
Elle remonte son plaid de laine, se tourne sur le côté. Elle sait que le sommeil ne viendra plus, qu’il
lui faudra attendre la pointe du jour avant de se lever. Que les heures seront longues à user entre les quatre murs de pierre, dans le jardin envahi de lierre et de lichen, au milieu de la combe
où jamais personne ne passe, sauf quelques animaux en maraude. Les tensions courent longtemps dans sa cage de chair, jusqu’à l’épuisement qui la fait sombrer un instant dans un état cotonneux
dense comme la mousse.
Alors elle revoit en rêve son long périple à Callonges, ses jours de couture sous la lumière grise,
l’incapacité de Milien à se fixer sur une tâche précise, son obstination à jouer de l’accordéon dans les rues étroites, du côté de la cathédrale, sur la Place du Marché ;
elle revoit les ensembles, les tailleurs qu’elle apporte à son oncle Gary dans de grands papiers de soie beige, leurs repas dans la salle basse et enfumée
de La Table d’Epicure ; elle entend les rires qui fusent, une joie tout innocente, simple, où chaque jour est un accomplissement, un cercle parfait qui se suffit à lui-même.
Puis une brusque déchirure, les longs couloirs blancs de l'hôpital, le ballet des infirmières, des
médecins, le diagnostic sans appel, la mort de Gary il y a dix ans, à la suite d’une pneumonie aiguë ; la douleur, le travail
qui vient à manquer, les petits travaux de ménage, parfois quelques retouches pour les magasins de prêt-à-porter ; enfin la longue descente vers les franges, les marges, le côté ombreux des
rues, la vie recluse dans « La Maison Perdue », le
glissement de Milien dans la déraison, les yeux dans le vague, le langage à la dérive.
Le vent a forci, cinglant les angles de pierre, lacérant les ronces et les genévriers, usant les
moignons de calcaire, les tubercules des souches, les racines noires qui courent sur le sol. Pour Marie-Odile le réveil est long, douloureux, les muscles noués, les os perclus d’humidité. Sur
le réchaud émaillé elle met de l’eau à chauffer pour le café. Elle en boit quelques gorgées lentement, laissant ses mains se réchauffer au contact du bol. Mélangé à la chicorée, le maigre fumet
s’est répandu dans la pièce, a réveillé Milien qui réclame sa boisson chaude comme le ferait un enfant
capricieux. Marie-Odile cale son dos avec un coussin, l’aide à laper un peu de liquide, prenant soin de ne pas trop incliner la tasse pour éviter l’engouement, faciliter la
déglutition.
Milien est si fragile, juste la transparence d’une porcelaine. Alors, avant de le
quitter, elle prend mille précautions. Elle l’assoit sur son fauteuil d’osier, tout près du poêle où rougeoient quelques braises, elle le couvre de son plaid, glisse entre ses mains une vieille
revue de L’Illustration qu’il consulte compulsivement, émettant parfois de petits grognements de contentement, parfois des plaintes, des soupirs de
désapprobation. Marie-Odile prend son cabas de toile cirée, tire la porte sur elle sans la fermer
complètement. L’air, venu du nord, est sec, coupant. Elle descend le long de la combe sur le chemin de gravier envahi de lianes d’églantiers, de bouquets d’orties, des maigres tiges des
bouillons-blancs.
VII - Une lumière en hiver
Dans la côte de Tertre
Rouge, quelques voitures la dépassent, chargées de fruits et de légumes. Puis les premiers immeubles de la cité, le Centre communautaire avec son grand toit de tuiles rouges, ses piliers de bois
vernissés, ses immenses verrières, son jardin clôturé où jouent de tout jeunes enfants. Parfois elle en franchit le seuil, avec hésitation, retenue, mais le désir est plus fort. Ce qu’elle aime
surtout, c’est parler avec Angèle David, l’assistante sociale,
lui raconter sa vie d’autrefois, Boulevard du Temple. Alors, au fond de son sac, elle a toujours avec elle de vieilles photographies qu’elle montre avec fierté et nostalgie : son père en
costume de golf, prince de Galles ; sa mère en robe noire et chapeau façon Coco Chanel, une rivière de perles autour du cou ; elle, Marie-Odile, à l’âge de huit ans, vêtue d’une robe courte qui dévoile ses genoux, un
empiècement de toile plissée sur les épaules ; un vieux catalogue du Cirque d’Hiver ; une vue du Canal Saint-Martin au Square des Récollets ; son oncle en 1910, en habit de
fantassin et, pêle-mêle, quelques tickets de métro, de cinéma, des bouts d’agendas avec des notes manuscrites, des bons de livraison du Sentier, des feuilles séchées du Square Pasdeloup. A peu
près tout ce qui lui reste de son enfance, de sa jeunesse avant sa fugue avec Milien pour rejoindre Callonges, la suite des jours heureux puis la brusque plongée, la
descente dans une spirale sans fin après la disparition de son oncle.
VIII - La Glaneuse
Elle dépasse le Centre, la
scierie Lassagne où on lui donne régulièrement des sacs de copeaux, des rognures de bois, des écorces pour le chauffage. Puis elle descend la longue côte de Lapeyre, croisée par des automobiles
chargées de pots de chrysanthèmes aux têtes jaunes et mauves, que poursuit une odeur fade de crypte et de pierres tombales. Un arrêt sur le pont du Dol. L’eau est claire, semée de galets qui
réverbèrent la lumière. Plus haut, l’ancien mur d’enceinte en tuileaux roses, la tour de guet, la fortification de la prison avec ses étroites grilles noires et, vers le sud, la cathédrale, son
clocher forteresse, ses deux dômes d’ardoise, la pyramide bleue de son abside dans les brumes naissantes de l’est.
Sur la place du Marché, les rangées de toiles multicolores, les étals autour desquels on se presse,
vêtus d’anoraks, de manteaux, faisant des emplettes rapides, pressés de regagner la chaleur des maisons alors que Toussaint se profile, sa lumière basse, son air poisseux, ses toiles de givre
accrochées aux nervures des feuilles. Marie-Odile tourne l’angle de la halle, entre par la porte la plus sombre. Dans un recoin,
une cuve de plastique où l’on jette les fanes, les déchets, les fruits abîmés. Avant même qu’elle en ait soulevé le couvercle pour y prendre quelques restes, elle entend déjà les quolibets fuser,
ricocher dans l’enceinte meurtrie de sa tête :
« Va donc retrouver ton Milien, la Glaneuse, y a rien
d’autre à prendre ici que du froid et de la misère. »
Et les rires ondulent entre les piliers de brique, se mêlent aux poutrelles, résonnent sur le sol de
ciment, vrillent ses oreilles comme un vol de frelons. Alors elle ne sait plus très bien si les mots, tranchants comme des lames, elle les a réellement entendus ou s’ils n’ont été qu’une
illusion, une création de son imaginaire. Puis la halle se met à tourner à la façon d’un carrousel avec le cercle étroit de ses lampes, les festons de son toit, les plaques lisses de ses
verrières. Et la chute de Marie-Odile est sans fin, douce, presque une consolation, la découverte d’une vérité nue,
blanche, où le monde a disparu, où il n’y a plus qu’elle, Marie-Odile, face à sa vie qui, jusqu’ici, ressemblait si fort à l’empilement du vide, au cercle de l’absence, à la croissance du néant.
C’est soudain un flottement, la coulée d’un air fluide, des notes sereines comme autrefois Boulevard du
Temple quand elle écoutait Albinoni, Diabelli et plus rien alors ne comptait que la musique, plus rien n’avait d’importance que la soie légère des étoffes, les risées de vent sur le dôme du
Cirque, sa perte vers les Filles du Calvaire, sa dispersion dans les frondaisons tout près des Blancs Manteaux. Soudain l’air se réchauffe, sorte d’écume qui entoure le corps meurtri de la
Glaneuse, des voix lui parviennent, douces, voilées, comme au travers d’une brume légère. On cale sa tête avec des oreillers, on approche de ses lèvres une tasse de thé parfumé, une main
lisse les rides de son front, cherchant à les déplisser, à en atténuer la rigueur. Marie-Odile ouvre les yeux. La chambre est grande, lumineuse et au travers de la baie vitrée
on aperçoit les peupliers, leurs dernières feuilles, minces cailloux dans l’eau claire d’une rivière. Une jeune femme vêtue de blanc s’approche du lit. Sa voix est calme,
rassurante :
« Ne vous inquiétez pas Marie-Odile. Vous êtes à l’hôpital. Vous
avez eu un léger malaise au marché. Il faut dire, avec ce froid, vous étiez si peu vêtue, et puis la fatigue, les soucis. Et Milien tout seul au milieu de sa combe qui se croyait perdu. On a dû
l’emmener à Blaymont, vous savez là où on s’occupe des malades mentaux, des dépressifs. Oh, ne vous inquiétez pas, c’est sans doute passager. Et puis vous pourrez aller le voir, une ambulance
vous y conduira. Mais je dois vous prévenir, Milien a un peu perdu la tête. Il a toutes sortes de visions, de paroles étranges mais il n’en souffre pas. Allez, Marie-Odile, reposez-vous
maintenant, et quand tout ira mieux, je vous ferai passer une robe, il y a quelques retouches à faire ».
IX - L’ultime conviction
Combe Gignac. Hiver 1982
Le ciel est gris,
charbonneux, ses volutes posées sur la tête des chênes, des prunelliers. Du marché, la Glaneuse a ramené quelques feuilles de céleri, des fanes de poireaux, des pommes tachées. Sur la table
quelques coupons de tissu en désordre, des patrons, les grands ciseaux d’Henri,
son mètre ruban, le hérisson piqué d’aiguilles, le fer avec la pattemouille : tout l’héritage paternel rassemblé en quelques objets épars. A la mort de ses parents, le petit immeuble du
Boulevard du Temple a été légué aux Blancs Manteaux. Milien est mort il y a quelques mois, à Blaymont, entre deux crises de
délire. Marie-Odile continue à vivre de maigres travaux de couture, de bons d’aide sociale, de la générosité de quelques habitants de Tertre Rouge.
Le froid est trop vif ce matin pour sortir dans la ravine. Elle rajoute quelques copeaux dans le poêle,
tisonne les braises, actionne le soufflet. Soudain, dans sa mémoire usée, la résurgence d’un souvenir lointain. Elle ouvre le buffet. Dans une boîte de métal une lettre jaunie par les ans. Celle
de son oncle Gary. Elle se souvient de sa promesse à
elle, Marie-Odile, de la lire le plus tard possible, quand la
vieillesse aurait usé l’émotion, tari les larmes, atténué le ressentiment. Alors elle sait qu’une vérité va s’ouvrir, peut être donner un sens aux jours qui lui restent à vivre. Cette certitude
bientôt révélée elle en a toujours eu le pressentiment, depuis sa première rencontre avec Milien entre les murs clos et muets des Blancs Manteaux. La lame du couteau déchire
l’enveloppe durcie à la manière d’un parchemin. L’écriture de son oncle, peu de temps avant sa mort, hésitante, penchée, parfois difficilement lisible.
Callonges, Septembre 68
Chère Marie-Odile,
Voici
donc le temps venu de me pencher sur mon passé, sur le tien aussi, toutes choses étant liées. Cela fait 35 ans que tu as rejoint Callonges en compagnie de Milien, 35 ans que la vie coule sans trop d’anicroches, sauf peut être la léthargie de
ton musicien qui ne semble guère disposé à t’aider, obnubilé qu’il est par son piano à bretelles. Mais, vois-tu, Milien a des circonstances atténuantes. L’Orphelinat, les Blancs Manteaux, on n’en sort jamais indemne et aujourd’hui ce grand adolescent qu’il a toujours
été, paie au centuple le prix de son abandon. Milien, en
effet, n’a jamais été orphelin au sens où on l’entend communément. Ses parents l’ont abandonné pour des raisons qui leur appartiennent et que nous n’avons pas à juger. Pour eux, élever leur
enfant, aurait été une trop grande souffrance. Maintenant qu’Henri et Marguerite ne sont plus là, il est de mon devoir de te dire la vérité, fût-elle cinglante, comme le sont toujours les vérités cachées. Dans tes veines, dans
celles de Milien, c’est le même sang qui coule. En
effet, Milien est le fils naturel de ton père Henri et de Florette Gervais, une midinette du Cirque d’Hiver qui était aussi frivole que bonne
écuyère mais n’entendait rien à l’élevage des enfants. Leur idylle a duré le temps des feuilles mortes. Quant à ton père, il était fiancé et tenait trop à Marguerite pour compromettre leur avenir commun, mettre en danger la boutique de tailleur qui sortait tout juste des limbes. Henri, connaissant les Blancs Manteaux, pour y livrer souvent uniformes et longs
vêtements blancs, a négocié l’admission deMilien.
Je ne
voulais pas que tu vives plus longtemps dans « La Maison Perdue », aux côtés de ton demi-frère, dans l’ignorance de vos liens réels. Continue de l’entourer des soins dont, jusqu’à présent, tu as toujours été prodigue. La révélation que je
viens de te faire, la conscience de Milien n’en pourra être atteinte mais la tienne en sera
éclairée.
Je
t’embrasse, Mario, espérant ne pas t’avoir causé trop de
chagrin.
Ton vieil oncle Gary.
Quelques jours ont passé depuis la lettre d’oncle Gary. Au Centre communautaire, Angèle David s’étonne de ne plus apercevoir, dans la côte de Tertre Rouge, la frêle silhouette de Marie-Odile. Elle se rend dans la Combe Gignac, auprès de « La Maison Perdue ». Le vent fait battre les volets. Un rideau de tulle passe au
travers d’une vitre brisée. La porte d’entrée n’est pas verrouillée. Angèle la pousse, faisant entrer avec elle un jour gris et humide. Au sol, près de la
cheminée où grésillent quelques braises, le corps étroit de Marie-Odile, une lettre froissée, des photos qu’elle reconnaît, le Canal Saint-Martin, les notes du Sentier, le catalogue du Cirque d’Hiver, une photo usée
de Milien. La jeune femme tire la porte sur elle, remonte la
combe en direction de la cité. Les nuages sont bas, piégés entre ciel et terre. Des bourrasques soulèvent les feuilles mortes. L’hiver sera rude à Callonges, dans le goulet des rues étroites,
alors que l’ombre de Marie-Odile les aura désertées.






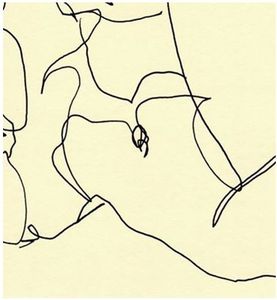


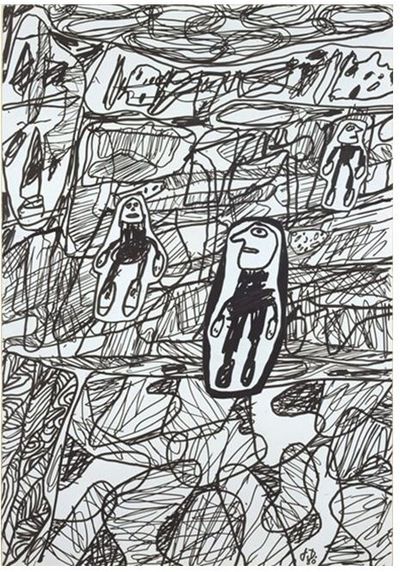





/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)