Le texte qui suit n'a nullement la prétention de constituer un discours rigoureux et logique sur la lumière. Il a seulement pour visée de la mettre en évidence selon quelques nervures existentielles et d'en réaliser une approche métaphorique. Ainsi y aura-t-il de constantes convergences entre lumière et expériences de vie, entre lumière et œuvres picturales. Ces dernières étant, pour la plupart, non libres de droit, le lecteur pourra se reporter utilement à Google images afin de mettre en relation les thèses évoquées à leur sujet et la réalité de leur représentation.
"Que la lumière soit et la lumière fut"
Ce que l'imagination humaine retiendra du FIAT LUX, c'est moins sa signification biblique, religieuse, que la dimension créatrice du langage. Etonnante valeur performative de l'énoncé où la parole et l'acte même se confondent. Etonnante genèse au sens d'une création originelle inouïe. Dans cette interprétation où le rôle du langage est premier, la parole se met à supplanter Dieu lui-même, lequel, dans une sorte de généreuse hypostase, lui aurait laissé la prééminence. Si le langage constitue l'essence de l'homme ,- gageons qu'il en soit ainsi -, alors tout homme parlant devient, par la seule vertu de ses énonciations, Le Créateur. Le Transcendant s'efface devant la transcendance, devant la pure sortie humaine du néant. Dès lors tout acte langagier garde en lui l'empreinte originelle de la lumière. Aussi bien le simple mot, aussi bien le rocher, l'arbre, le fleuve. Car rien n'est conçu ex nihilo mais résulte d'un acte de nomination qui assure sa phénoménalité, concourt à son rayonnement. Tout langage, toute parole, tout signe deviennent éminemment signifiants. Aussi bien la lézarde sinuant sur la face de la terre, aussi bien les signes semés sur le sol par les indiens Taharumaras, aussi bien l'œuvre d'art, le clignotement d'Algol dans la constellation de Persée.
Mais la lumière ne joue jamais sa partition d'une façon solitaire. Il lui faut sa part de réverbération, une surface sur laquelle imprimer sa trace. La lumière est la page; l'ombre le signe, le chiffre jouant en contrepoint. Lumière sur ombre. Ombre sur lumière. Jamais ombre sur ombre. Jamais lumière sur lumière. Constante dialectique. Immémorial rapport de sens.
Mais parfois la prolifération des signes couvre la totalité de la page et alors n'apparaît plus la blancheur et alors n'apparaît plus la lumière. Le sens peu à peu s'efface comme si sa profusion même concourait à son occultation. Confondante condition humaine où les significations, dans leur usure, dans leur persistance à être, ne révèlent plus que leur perspective métaphysique. Comme un retour au néant originel.
LETTRE AUX GUETTEURS DE LUMIERE
Non, ne le niez pas, vous la possédez depuis l'enfance cette manière de vérité. Déjà elle vous habitait du temps de votre repli fœtal, au sein de la grotte amniotique. Déjà, au-dessus de votre fragile fontanelle, se déployait un dôme de lumière diaphane, opalescente. Vous en étiez éclairé de l'intérieur. Cela faisait de rapides trajets, depuis la boule informe de votre tête jusqu'à la nervure des orteils. Cela fusait de vos yeux aveugles et soudés, cela détourait vos mains jointives et transparentes comme l'ambre, cela sinuait dans le lacis de votre ventre, cela s'étoilait dans les rhizomes de vos nerfs, cela battait doucement comme l'écume sur les rochers de lave. Vous n'aviez rien d'autre à faire que de vous laisser aller à la migration de la clarté, de disposer votre peau translucide à l'avancée de la lumière. Rien d'autre à faire. Un suspens seulement. Une attente de l'événement. Une passivité ouverte. Une affinité occupée à son propre déploiement. Une pure conscience végétative livrée aux eaux originelles. Tout ceci vous habitait si naturellement, d'une façon si enveloppante, comme une deuxième peau, comme un souffle déplissant vos alvéoles. Cela coulait en vous dans le genre d'une lymphe baignant vos vaisseaux, vos cellules. Tout au long du cordon qui vous reliait à la vie, le patient voyage des nutriments, l'avancée de l'oxygène, la diffusion de l'eau, le fourmillement des globules, tout ceci n'était que la mise en scène de la lumière, de son long métabolisme, de sa volonté de coloniser jusqu'à la plus infime de vos parcelles, jusqu'au dernier atome de votre territoire de chair et de sang.
Donc la lumière vous a envahi, à votre insu, semblable à une marée d'équinoxe. Seulement la marée ne s'est jamais retirée. Elle s'est invaginée dans la moindre de vos cryptes, elle s'est réfugiée dans la plus infime de vos scissures, elle s'est installée dans l'étendue invisible de votre caverne d'os et de peau. Tellement liée à vous, tellement coalescente à votre condition qu'elle en est devenue inapparente, fluide. Pour autant elle n'a jamais cessé de faire votre siège, de guider vos pas, de modeler votre anatomie, d'éclairer vos gestes, de faire briller vos yeux, d'allumer sur votre front de rapides fulgurations semblables aux scintillements des comètes.
Seulement la nature de la lumière est de rayonner, de parcourir l'espace de ses flèches rapides, d'éclairer le sommet des montagnes, de se poser à la crête des rochers, de faire de la terre un miroir, d'imprimer des ondes jusqu'au profond des abîmes.
Seulement la nature de l'homme l'incline souvent à ignorer ce qui, de soi-même, se révèle dans une sorte d'évidence. Comment s'étonner de la lumière ? Comment s'étonner de l'ascension du soleil le matin, de la vibration de la ligne d'horizon, de l'incandescence blanche au centre du ciel ? Comment davantage s'étonner de la chute de l'étoile du zénith au nadir, de sa disparition, chaque soir, derrière les collines envahies d'ombre et de froid ? Tout ceci est tellement dans l'ordre des choses. Tout ceci est si habituel que seuls les rouages apparaissent aux yeux des hommes, seule la mécanique céleste bien huilée, l'enchaînement méthodique des heures, le mouvement perpétuel des secondes. Mais les rouages ne sont que les apparences, des leurres réduits à leur simple phénoménalité, de simples pièces d'horlogerie qu'anime la lumière. Alors qu'en est-il de la lumière ? Est-elle si difficile à appréhender qu'on n'en puisse rien dire ? Sans doute ne peut-on rien en dire puisque nos paroles, nos mots, ne sont que sa propre mise en acte. Il faudrait entre l'homme et son langage, entre l'homme et ses créations, l'espace de la différence afin que puisse surgir un étalon, une mesure, une dimension à partir de laquelle pouvoir appréhender son essence, sa loi de constitution, sa réalité intime. Or la lumière ne nous livrera jamais que quelques unes de ses lignes de fuite, de ses perspectives, quelques unes de ses projections. Quel langage, autre que celui de leur propre rayonnement, pourraient nous adresser le soleil, l'étoile, la comète, l'étincelle ? Il semble bien qu'il y ait une réalité indépassable, une frontière infranchissable. Il faudrait, à la fois, être au cœur de la matière et en dehors d'elle, être l'écorce et le regard qui l'enveloppe; être la sculpture et la conscience qui l'anime; la jarre et l'esprit qui la façonne. Mais cette ubiquité n'est jamais dimensionnellement humaine. Sans doute est-elle l'apanage des dieux, donc inaccessible à notre propre condition.
Inutile de chercher à expliquer ce langage secret de la lumière par l'existence d'un supposé arrière-monde, par une habile métaphysique, par une philosophie originelle nous délivrant de nos questions fondamentales. Quant aux explications de nature divine, elles ne feraient que nous soustraire à nos angoisses existentielles. Sans doute celles-ci sont-elles plus pertinentes que celles-là. Cependant rien ne saurait nous priver de certains "ravissements" intellectuels tels que peuvent nous les procurer les Idées platoniciennes; les écrits mystiques des Sages de l'ancienne Perse, la transcendance de l'art, la beauté des métaphores poétiques, la fascination du génie, la brûlure de la folie. Tout, dans ces diverses épiphanies, nous parle de lumière. Tout nous invite à la mydriase face aux reflets, aux ondes, face à la singulière présence des nuées de phosphènes.
Que dire devant tant de beauté ? Plutôt le silence, la méditation, le recueillement, plutôt la mutité. Ou bien assumer le contrepied : la démesure du dire, le déferlement de la parole, le chant polyphonique où se révèlent à nous, dans une sorte d'évidence esthétique, tous les bruissements de la clarté, leur présence sous l'inapparent, leur persistance à vouloir signifier.
Bien sûr, de la lumière nous pourrions parler, comme nous le ferions de choses lointaines. Vous, aussi bien que moi, aussi bien que tous les hommes de la terre. Nous pourrions parler des hauts plateaux où souffle le vent, des courants lumineux qu'il imprime au milieu des nuages; nous pourrions parler de la pluie si fragile, évanescente, impalpable; des gouttes comme autant de mystères; de l'éclat de la neige; des failles bleues des icebergs; du miroir des rizières; du cercle éblouissant des coraux; des dolines où se perdent les eaux cristallines; des concrétions souterraines pareilles à des gemmes; des résurgences phosphorescentes au creux du calcite; des falaises de talc au-dessus des eaux turquoises; du surgissement blanc des mouettes sur la toile du ciel. Nous pourrions parler des villes aux tours d'acier, aux escaliers de verre; des barres de néon qui rythment la nuit; du clignotement des bars aux enseignes rouges et vertes; des éclairs des tramways; des musiques colorées; des conciliabules qui sillonnent le visage des hommes; du désir illuminant les hanches des femmes, et nous parlerions toujours de la lumière, rien que de la lumière. Et cela vous le savez depuis la nuit des temps. Tout est lumière, seulement lumière. Dites "âme"; "esprit"; "conscience"; "langage" et vous ne dites, en réalité, que "lumière"; "lumière"; "lumière". Vous-même êtes un fragment de cette lumière universelle, de cette clarté sans début ni fin, sans origine ni but, qui parcourt des myriades d'espaces, des nuées de temps. Tous les hommes la savent cette vérité mais bien peu l'assument, collés qu'ils sont à leurs certitudes étroites, dissimulant leurs yeux derrières de minces meurtrières. Avouer cette présence en soi de la lumière, c'est s'exposer au questionnement multiple, à la brûlure, à l'incandescence. Alors vous n'êtes plus qu'un photon dans la longue chaîne lumineuse. Un photon parmi des milliards d'autres. C'est pour cette raison que vous devenez, en une certaine manière, invisible à votre propre regard. Vous êtes atteint de la démesure de la lumière; immergé dans la clarté, simple fusion parmi l'universelle fusion.
Cependant il vous est possible de trouver une issue, de regrouper vos fragments épars, de les assembler en une architecture vraisemblable. C'est de l'ombre que surgira un début de réponse. L'ombre comme simple modalité de la lumière. Non son envers mais sa justification, le tremplin à partir duquel elle peut surgir. Ouvrez vos yeux, dilatez vos pupilles, cernez de près votre horizon existentiel, celui de vos semblables aussi. Oui, cela s'anime déjà. Faiblement, il est vrai. A la manière de silhouettes cendrées sur un ciel hivernal. Mais c'est déjà un début d'explication, le faible surgissement d'une parole fécondant la nuit. Les formes bougent, font des pas de deux, d'hésitantes chorégraphies. Oui, dilatez encore le puits de votre regard, distendez l'iris, fendez la sclérotique, dépliez la membrane de votre conscience. Maintenant, vous sentez, tout au bord de votre visage, sur la plaine de votre peau, comme un fourmillement pressé, une multitude impatiente, la migration d'un peuple nomade en marche vers son destin. C'est encore une vue d'astigmate qui vous habite et les formes se dédoublent, se croisent, se multiplient, se percutent. La courbe de vos yeux est assaillie de rapides hiéroglyphes, de signes multiples ouvrant vers une possible dramaturgie. C'est encore, pour vous, de l'inconnaissance, de l'insu, du mystère. Puis, soudain, un basculement, et tout ce qui vous était étranger, extérieur, à la limite de l'hostile, vient de surgir au sein même de votre territoire de chair. Le peuple des signes franchit la porte étroite de votre chiasma, glisse le long de vos axones, débouche sur l'écran blanc, dans votre conque d'os, et c'est alors semblable à l'ouverture d'un vaste espace, et c'est alors une agora peuplée de milliers de voix, de milliers de mouvements et les petits signes noirs et blancs, rapides clignotements d'ombre et de lumière, vous les reconnaissez et les signaux de morse ne sont que vos propres chiffres, votre alphabet intime, celui qui donne sens à votre empreinte sur la Terre, trace votre chemin, creuse votre sillon dans la glaise humaine. Vous n'existez qu'à être un sémaphore - un "porte-signes" -, vous ne faites phénomène qu'à la mesure des messages que vous émettez - bras droit baissé; bras gauche levé; les deux bras horizontaux; deux bras en V au-dessus de votre tête -, vous n'êtes qu'une gesticulation à la face des choses, une tresse de fumée dans le ciel des Cherokees, des Cheyennes, des Comanches; vous n'apparaissez aux autres qu'à la manière d'un pictogramme mésopotamien, suite d'incisions dans les tablettes de pierre; à la façon des bâtons-messages primitifs, étonnants dessins piqués dans le bois, rythme de traits gravés. Identiquement aux figures qui peuplent la terre - sillons; ravines; mosaïques des champs; ergs; lignes de cairns - , vous appartenez, le sachant ou à votre insu, au "pays des signes", à ce pays semblable au sol des Indiens Taharumaras, longue sémantique géologique, recueil vivant dans lequel les hommes peuvent vivre leur propre histoire et, au-delà, les secrets de leur origine.
La sierra du nord du Mexique, terre sèche, aride, parcourue de pierres, apparaît en tous points identique à une concrétion de la lumière, langage à déchiffrer, riche de sens multiples. Comment pourrait-il en être autrement alors que s'entrelacent, dans une étonnante harmonie, le geste de la Nature, celui des dieux, celui des hommes ? Le visible rejoignant l'invisible.
"Cette sierra habitée et qui souffle une pensée métaphysique dans ses rochers, les Taharumaras l'ont semée de signes parfaitement conscients, intelligents et concertés".
(Antonin Artaud).
Comment mieux dire le caractère transcendant de l'acte humain, son inscription à même le rocher, sa trace dans le sol à la longue mémoire ? Etroite filiation des hommes et des dieux. Grande arche d'alliance où se fondent, dans un même creuset, gestes profanes et figures sacrées. Si tous ces graphismes se transforment en sèmes, si ces essais picturaux, ces effigies telluriques nous parlent au travers des âges, c'est bien grâce au regard que l'homme porte sur les choses, à sa lumière qui ouvre la connaissance, à sa clarté qui traverse le voile des apparences.
La longue aventure de l'homme sur terre : clignotements de lucioles entre deux pans de nuit. Celui de l'origine. Celui de la fin. Cette aventure est aussi la vôtre et ce rythme syncopé de l'ombre et de la lumière - tellement semblable à celui du nycthémère; à la pulsation diastole-systole; au plissement-déplissement alvéolaire -, ce rythme vous ne le percevez qu'à pénétrer phénoménologiquement l'essence dissimulée sous les apparences. A savoir : vous relier à votre propre nature, à ce qui fait de vous un être unique parmi la multitude. Cependant, il faudra faire halte, initier un suspens dans le cours de votre vécu, le poser devant vous comme le peintre le ferait d'un modèle et, de cette césure, de cette observation minutieuse, attentive, réfléchie, naîtront des sensations, des émotions, quantité de savoirs oubliés, de séquences refoulées, de faibles signaux brillant encore d'un éclat assourdi sur l'arc de la conscience. Il vous faudra alors inverser votre regard, retourner votre peau, fouiller les chairs, déplier les téguments, sonder les os, glisser le long de vos vaisseaux. Ce sera comme de rembobiner un film en noir et blanc, de tourner la manivelle de la lanterne magique et, devant vous, sur l'écran de votre lucidité, les images tressauteront, lumineuses ou ternes, belles ou tristes, généreuses ou réduites à une peau de chagrin. Mais peu importent les états d'âme, les failles, les chausse-trappes, les passages à vide, les atermoiements, les renonciations, les promesses tenues et non tenues, les faux engagements, les ambitions, les compromissions, les reniements. Vous n'aurez pas à relater votre propre vie, à en décrire les anecdotes, à en faire la matière d'un feuilleton. Foin des faits, des événements. Ils ne sont que des épiphénomènes qui vous éloignent de votre propre vérité. Ce que vous aurez à décrypter : seulement le rapport de l'ombre et de la lumière, leur commune dialectique, leur point d'articulation, parfois leur jeu de concert, mais aussi leurs limites, leurs divergences, leurs tensions. Surtout saisir leurs territoires relatifs, les avancées et les reculs, les points de non-retour. Car, voyez-vous, un artiste pourrait, en quelques traits de fusain, quelques hachures, quelques estompes faire le résumé de votre vie. Trois nuances fondamentales -gris; blanc; noir -, et tout serait dit de vous, de votre vie, de la lutte sans fin d'Eros et de Thanatos qui parcourt les linéaments de votre corps, les fluctuations de votre pensée, la tonalité de vos affects. Vous-même réduit à ce chromatisme étroit à partir duquel il n'y a plus de fuite possible. Quelle autre issue, en effet, que la naissance, la vie, la mort ? Porte nocturne, porte diurne, porte nocturne. Aventure ontologique réduite à deux passages : de l'ombre à la lumière; de la lumière à l'ombre.
Allumons maintenant la lanterne magique de l'existence et laissons défiler les images sur la grande toile blanche de l'humain. Nous y percevons de tremblantes silhouettes, d'hésitants pas de funambules. Une multitude d'itinéraires semblables à quelques traces dans la neige légère, seulement quelques essais de parole, quelques balbutiements afin que chaque aventure humaine prenne place dans la grande migration des peuples. Votre voyage, le mien, seulement quelques perspectives, quelques vols de hérons sur le fil de l'horizon. Une simple buée. Guère plus que cela. Guère plus qu'un ris de vent à la face de l'eau. Guère plus qu'une infime étincelle. Regardant vers votre passé, nous nous attacherons moins aux événements qui vous ont effleuré qu'aux affinités qui ont été les vôtres. Vos liens avec la nature, les paysages; vos passions multiples; vos fascinations pour les signes; votre attachement à la philosophie, à la littérature; vos éblouissements face à la peinture. C'est cela qui vous définit, dessine votre contour, assure votre originalité. Tout un réseau serré de relations avec les choses, tout un dialogue tissé avec le monde et, en retour, tout un langage du monde avec celui que vous êtes, dans la lumière de votre propre vérité. Tout un dialogue avec l'ombre, aussi, face cachée, trame métaphysique, envers si peu visible du lumineux, de l'évident, de ce qui signifie avec une sorte de nécessité existentielle. Car vous le savez, la lumière, dans la majesté de son rayonnement, porte toujours en elle les conditions mêmes de son abolition. Le soleil lui-même est mortel. Alors, comment pourrions-nous prétendre entretenir notre propre feu, alors que s'annoncent déjà les braises, alors que transparaît, sous la vie, l'incontournable cendre ?
Notre voyage ne sera que cette succession de clartés et d'ombres, suite de lueurs boréales, d'incendies équatoriaux, de touffeurs de forêts vierges, de vols au-dessus de la canopée où habitent les oiseaux au plumage de feu. Puis, parfois, de brusques repliements, des chutes dans des grottes aux parois de suie, au milieu des vols hésitants et contradictoires des chauve-souris. Notre voyage ? Semblable au clignotement des étoiles, aux phosphorescences des lacs la nuit; aux collines blanchies de lune; aux trous d'épingle des lampyres dans les hautes herbes. Une sorte de clair-obscur au sein duquel il nous faudra tracer notre propre ligne, graver quelques signes en forme de points de suspension.
C'est donc par votre ombilic que la lumière est entrée en vous alors que vous n'étiez, dans la bulle amniotique, qu'une forme approximative, un genre de point d'interrogation. C'est autour de ce mince filament que, lumière après lumière, votre corps s'est construit. Longue hélice d'ADN assemblant pièce à pièce les fragments de votre architecture. Mais votre conscience, seulement végétative, ne pouvait alors en être éclairée. Vous étiez soudé à la Terre-Mère, vague racine plongeant dans l'humus originel. Non encore séparé, vous n'étiez qu'une manière de parasite attaché à son hôte; gale du chêne puisant son suc à même sa propre généalogie. Sans doute perceviez-vous de vagues ondes aquatiques porteuses d'une clarté assourdie ? Comme une promesse de vie. Mais votre première lumière n'était pas visuelle. Vous étiez alors atteint de cécité, à la manière des chiots qui, tout juste nés, progressent vers le lait maternel sans même discerner le lieu d'où il ruisselle. Vous étiez, de par votre inachèvement, de l'ordre de l'animal, peut-être du végétal ou même du minéral, simple remuement géologique dans les plis du limon. Votre première lumière n'était ni phosphène ni onde, mais lumière matérielle, compacte, charnelle. Votre première lumière était dyadique. Elle pénétrait votre fontanelle biologique, fusait le long de l'ombilic et c'était comme une glaise qui aurait été pétrie, étirée, modelée, mise en forme. Une lumière tactile, digitale, une lumière-gouge qui taillait à même l'âme de votre bois souple et disponible. Une lumière esthétique qui vous sculptait à votre insu. Des prémices, des prolégomènes d'un sens ultérieur que, bien plus tard, vous retrouveriez sous des formes métamorphosées, presque inapparentes mais ô combien liées à votre souffle, votre sang, votre peau. Déjà se définissaient, dans l'indistinction du lieu primitif, les premières polarités, les germes élémentaires qui orienteraient vos pas, détermineraient vos goûts, affirmeraient vos tendances. Rien moins que votre essence, votre nature propre dans ces traces à peine visibles qui commençaient à vous habiter, à imprimer à vos gestes une singulière plasticité. Unique. Car c'est bien là la merveille. Parmi la vaste marée humaine, vous êtes une levée d'eau à nulle autre pareille, une goutte au contour précis, un filament autonome au centre des cataractes qui, partout, parcourent le monde. C'est cette évidence qu'il convient de faire émerger afin de faire retour vers vos attaches, vos fondements. Comment y avoir accès, sinon par la magie des lieux, du langage, de la beauté ? Mais pas n'importe quelle magie. La vôtre, celle qui fait briller votre regard, mouvoir vos jambes, animer vos mains. C'est dans les œuvres belles qui vous entourent, vous touchent, vous parlent qu'est la seule réponse. Nulle part ailleurs. Un léger décalage de la vue et la perspective s'est déplacée et d'autres œuvres apparaissent, mais en trompe-l'œil, à la façon d'étranges artefacts. Ici, vous êtes dans le domaine de l'Autre, de celui qui vous fait face, sans doute vous ressemble mais vous est étranger. Pour la simple raison que vous n'habitez pas sa tunique de peau, ne voyez pas par ses yeux, n'entendez pas par ses oreilles, ne vous mouvez pas par ses jambes. Vos affinités, vos points de contact avec le monde sont uniques, absolument uniques. Mais revenons aux œuvres, aussi bien aux paysages qu'aux poèmes, aussi bien aux tableaux. Faisons halte, un instant, dans votre "Musée" personnel. Sans doute ressemble-t-il au "Musée imaginaire" auquel André Malraux faisait allusion. Rappelons l'une des thèses majeures développées par l'auteur de "La métamorphose des dieux" :
Tout objet peut prétendre au statut d'œuvre d'art. Peu importe sa provenance, son époque, son esthétique. Il doit simplement se situer au centre d'un dialogue que l'homme instaure avec lui. Il y a alors, dans cette relation réciproque, de l'homme à l'objet, de l'objet à l'homme, communion, fusion, appartenance intime. Comprenons : visé par le regard, l'objet acquiert un statut transcendantal. Il signifie et rayonne, ouvre un monde, crée les conditions d'une éclaircie. Ainsi, tout parcours humain, nécessairement contingent, a-t-il besoin, pour signifier, de rencontres fondatrices. Sans doute l'objet sublimé par l'art l'est-il lui-même par un autre objet transcendant : la lumière comme condition même de son apparition. Toute œuvre, poème, sculpture, peinture, ne peut apparaître que dans cette clarté-là ou ne pas être. Toute œuvre est lumière, de par son existence même. C'est le sens insigne de sa présence parmi les hommes que de procurer au regard qui la rencontre sa charge de sens, "sa part d'éternité" disait Malraux. Aucune existence sur terre ne peut en faire l'économie, sauf à sombrer dans l'incompréhension.
Mais revenons à votre vécu, aux états de la lumière qui, successivement, ont dessiné votre forme, modelé votre pensée, irrigué vos sensations.
D'abord à "La naissance de Vénus" de Botticelli. Lors de vos premières expériences esthétiques, ce tableau a eu, d'emblée, valeur de symbole, d'œuvre originelle. C'est, bien sûr, de votre origine dont je veux parler. Non d'une origine abstraite comme peut l'être celle de l'humanité. C'est vous qui êtes en question, et seulement vous. Appliquant votre regard à l'œuvre du Maître, vous en preniez possession, elle vous appartenait, elle animait votre souffle, mobilisait vos alvéoles, dilatait vos poumons. "La naissance de Vénus" a quelque chose à voir avec votre naissance. De ce tableau vous ne pouvez faire qu'une lecture ascendante, comme si un flux vital l'animait depuis l'obscurité du limon jusqu'à la transparence de l'éther. Cette conque qui s'ouvre en éventail sur les flots brun-émeraude n'est qu'une métaphore, une sorte de duplication de la conque primitive qui vous offrait abri et possibilité d'essor. Cette conque est la matrice d'où surgit la lumière. Lumière-sève, germinale, lumière-crosse occupée à son unique déploiement. C'est de cette lumière qu'est constitué votre corps, aussi bien que le corps de Vénus qui en est la condensation, la réalisation matérielle. Lumière si pure, légère, marmoréenne, qu'elle semblerait atténuer les projets qu'Eros semble tisser à son insu. Le regard pudique, la pose chaste en attestent. L'attitude est apollinienne, loin du déchaînement dionysiaque et cependant la puissance créatrice est en voie d'accomplissement. En témoignent les nombreux signes allégoriques : le cortège du Printemps initié par Zéphyr et Chloris, repris en écho par l'une des Grâces dont les motifs floraux sont une ode à la création, à son irrésistible accomplissement. Bien sûr, cette œuvre est emblématique à bien des égards, cette œuvre est universelle comme le sont celles des génies et, beaucoup, sur terre, auront en même temps que vous éprouvé cette poussée, en eux, de la lumière. Aucune existence en sa profondeur ne saurait s'y soustraire. Ici la dimension n'est pas seulement anthropologique mais ontologique. Il y va, pour chacun, de sa puissance à être, à rayonner, à imprimer sa marque, à frayer son sillage.
Puis, de Botticelli, vous passez, sans transition, sans justification , -mais comment pourrait-il y en avoir une ? -, à l'œuvre de Georges de La Tour : "La Madeleine à la veilleuse". Alors que Botticelli répondait à vos interrogations d'enfant , -le dépliement de la lumière comme prélude à l'existence -, De La Tour vous offrait de plus profondes réflexions débouchant sur un questionnement adolescent. Conflit des éclairages, lois antagonistes du sombre et du lumineux, polemos du clair et de l'obscur. Ici, la lumière n'a plus à croître, à occuper l'espace, à inaugurer le temps. Ici, la lumière a simplement à se figer, à marquer une pause, à faire halte. Coin inséré entre l'innocence enfantine et la lucidité adulte. Aussi la lumière est-elle à peine évoquée, suggérée, simple émergence du noir avec lequel elle joue en mode dialectique.
Lumière-lagune, pénétrée d'un ciel lourd; lumière-glu où pensées et actes sont en attente du devenir, dans la tension de l'événement. Troublante beauté que celle de Madeleine, la femme pècheresse figée entre deux états : celui de la luxure, celui de la piété. Avec, en suspens, la conscience du repentir. Luxure de l'épaule dévoilée, de la douce courbure du ventre, des jambes plongeant dans une troublante obscurité. Jamais lumière ne vous aura autant ému, jamais lumière n'aura aussi clairement posé la question de l'ambiguïté existentielle. Jeu pervers du désir et de la mort. Chair luttant contre l'esprit. Densité terrestre opposée à l'éther céleste. Lumière-énigme inaugurant déjà, à votre insu, les rouages métaphysiques qui surgiront plus tard. Lumière intérieure, onirique, où la pensée piétine, fait des ronds dans l'eau; pensée spiralée pareille à la sombre giration ophidienne. Pensée du pêché. Pêché de la pensée. Et ce crâne aux orbites démesurées, si près du pubis, si près du Mont de Vénus. Eros tutoyant Thanatos. Plus tard vous penserez à Courbet, à son "Origine du monde", à son troublant réalisme. Seuil à franchir pour surgir dans l'âge adulte. Un point de non-retour. Comment vivre cela, cette peinture si fascinante de De la Tour, dans le vortex adolescent, sinon par un questionnement sans fin, une tension constante, un équilibre de funambule ? Lumière et ombre mêlées, où la vue, simplement ramenée à des considérations optiques, n'est plus d'aucun secours. Vue glauque, physiologique, tissulaire. Vue ombilicale, mais sans rapport avec celui de l'univers amniotique. Seulement ombilic refermé sur lui-même, simple bouton hermétique dans l'attente d'une ouverture du sens, du surgissement d'une lumière neuve, diffusant ses filaments au sein de votre espace mental. Il faudra une révélation, un basculement, il faudra l'irruption, dans la pérégrination adolescente, d'un événement majeur afin que les choses s'éclairent de l'extérieur. La révélation de l'identité sexuée sera l'opérateur qui réalisera l'indispensable métamorphose. Saut vertigineux de la conque primitive à l'ouverture en forme de corne d'abondance. La lumière maternelle, aquatique, amniotique, cèdera la place à l'éblouissement solaire, à l'archétype paternel faisant force de Loi.
L'instant d'une lucidité charnelle et la nature de la lumière sera passée de la bougie de De la Tour aux "Tournesols" de Van Gogh. Il n'y aura guère d'autre chemin possible pour assurer votre passage du marais adolescent à la maturité flamboyante. Le "Vase aux tournesols" de 1888 sera le médiateur, celui qui effacera les empreintes picturales précédentes, vous dotera d'un regard ample, ouvert sur le monde. Regard refoulant les ombres, les failles, les pertes dans d'hypothétiques abîmes. Une pleine lucidité consciente de son rayonnement, de sa puissance à exister. Acmé vitale, heure zénithale où plus rien de dangereux, d'angoissant, de mortifère ne peut plus vous atteindre. Les "Tournesols", vous les regarderez avec volupté, comme on regarde une maîtresse; avec passion, comme on se livre à la peinture, à la littérature, au chatoiement des idées. Un pur désir de vivre, de consommer jusqu'à l'excès la pulpe des jours. Un temps d'accomplissement se suffisant à lui-même. Vous, la peinture : une seule et même chose; un sentiment de participation, d'immersion. Vous serez à l'intérieur de sa matière même. En pleine "pâte existentielle". Comment ne pas reconnaître dans les jaunes lumineux, les jaunes orangés éclatants, les bleus céladon, les verts tendres, la silhouette même de votre propre efflorescence ? Un vertige. Un sentiment d'ascension, de turgescence. Identiquement à Van Gogh qui voulait faire de sa chambre jaune, à Arles, un centre d'irradiation de la lumière, vous serez pris dans ce tourbillon, dans cette irrésistible élévation qui vous projettera au-delà même de vos propres limites. Vous n'aurez alors besoin d'aucune métaphore, d'aucune poésie, pour appréhender ce que la transcendance veut dire. Une pure présence au cœur de la signification. Vivre aux côtés de Vincent, ce sera éprouver cette constante brûlure, ce sera comme de vous offrir, corps et âme, au jaillissement perpétuel, au surgissement d'une inépuisable vitalité physique, spirituelle. Car, sous la profusion, sous la pâte picturale tourmentée des "Tournesols", pâte pétrie, violentée, apparaît déjà la folie perçant sous le génie, se profilent les convulsions douloureuses de la "Nuit étoilée", le spectre de l'asile de Saint-Rémy de Provence. Sans doute en éprouviez-vous les ombres portées que, toujours, vous aviez souhaité ignorer. Les ombres seraient pour plus tard, lorsque le jour aurait décliné, que le corps se serait assagi, renonçant à son emprise sur la matière. Mais, pour l'instant, il s'agit de vivre, de fouler la terre avec, au-dessus de la tête, l'arc de la couronne solaire, environné d'une pluie de gouttes blanches, cerné de nuées étincelantes. Entouré de cette lumière plastique, tactile, de cette lumière cosmique qui lance ses traits dans l'éther. Mais il y a trop de couleur, de matière, de passion, trop de douleur que les yeux ne peuvent contenir, dont l'esprit ne parvient pas à épuiser le sens. Car la pure beauté ne peut se laisser longuement contempler. Il y a danger à tutoyer la démesure de l'œuvre. Et puis, toute incandescence est bientôt suivie d'une obscurité salvatrice. Loi de succession des contraires. La nuit après le jour.
Quelle étrange association d'idées, quelle fantaisie vous conduira alors de Van Gogh à De Chirico ? Le saut paraît irréel, presque surréaliste qui vous projettera du Van Gogh solaire au De Chirico nocturne, sombre, assailli par la question métaphysique. Peut-être la contemplation d'un des derniers tableaux de Vincent aura-t-elle influencé votre perception de l'art, sa dimension souvent tragique, sa lutte permanente contre Thanatos. Assurément, cette œuvre, - "Le champ de blé aux corbeaux", de 1890 -, est déconcertante, inquiétante et nul ne peut faire l'impasse des signes avant-coureurs d'une disparition, d'une perte prochaines. Le suicide, en effet, est imminent pour leHollandais.
Mais l'interprétation de votre volte-face n'est pas à chercher dans la signification de cette peinture, aussi révélatrice fût-elle du prochain surgissement du tragique. Plutôt dans votre itinéraire personnel, c'est à dire dans celui de tout homme ordinaire. Toute apogée est suivie d'un déclin, qu'il s'agisse de l'Histoire universelle, qu'il s'agisse des incertitudes et inflexions d'une existence particulière nécessairement contingente. Au flamboiement suscité par Van Gogh ne peut succéder qu'un repli, une perte. Ubac faisant suite à l'adret. L'exubérance des "Tournesols"; l'énergie tourmentée des oliviers; le ciel envahi par la giration des étoiles, laissent soudain place à la géométrie abstraite deDe Chirico, figée dans l'intellect, énigmatique; étrange statuaire aux yeux vides, étonnants mannequins désincarnés; personnages aux yeux soudés, aux corps de pierre blanche, blafarde, en partance pour l'au-delà.
C'es le "Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire" de 1914 qui retiendra votre attention. Tout, dans cette œuvre manifeste une inquiétante étrangeté; tout est placé sous le sceau de l'énigme, de l'incompréhensible. Mais ses symboles sous-jacents , - évocation de la poésie orphique que signent la présence du poisson et de la conque; sagesse liée à la cécité dans la mythologie grecque -, ne vous atteindront guère. Pour vous, la vraie dimension est existentielle, comme si le temps s'était inversé, avait retourné sa peau, faisant refluer la lumière très loin vers l'intérieur, dans une sorte d'espace inconnu. Lumière abyssale, aquatique, spectrale, s'immolant dans des tonalités froides, figées. Comme issue d'un rêve sans signification où l'on sombre soi-même dans une chute sans fin. Le corps se raidit, les bras s'écartent pour saisir encore un peu d'existence, quelques éclats de clarté mais la pesanteur est trop grande, l'attrait du vide irrésistible. Et alors le réveil est douloureux, la sueur profuse, les draps semblables à des vagues de pierre. Tout est soudain devenu minéral, lourd, hostile. Plus rien ne signifie vraiment que le plateau du lit où souffle un air glacé. Plus rien ne signifie qu'une immense vacuité et la solitude résonne sur les murs vides, couleur de talc. Sorte de rêve prémonitoire, manière de signe anticipateur d'une prochaine cécité. Il n'y aura plus alors, pour vous, que la possibilité d'une identification, d'une immersion dans la masse ombreuse de la toile.
Vous-même êtes le Poète. Mais le Poète-cible, le Poète-trépané. Les mots-météores, les mots-comètes qui cernaient votre front de sillages de feu, vous ne les reconnaissez plus. Par votre fontanelle, ils s'écoulent, milliers de lettres, milliers de petits crochets, nuées de points semblables à des cohortes d'insectes pressés. Ils sont réfugiés au creux de leurs tuniques, ont replié leurs élytres, soudé leurs mandibules. Ils ne brillent plus, ne parlent plus. Ils sont de lourds essaims au dessein secret qui tapissent vos pieds. Vous sentez leur grouillement multiple, leur lente progression le long de votre statue d'albâtre. Leurs pattes griffues s'accrochent à votre anatomie, à vos jambes glabres et lisses comme des colonnes antiques, à votre bassin de marbre; ils martèlent de leurs piétinements touffus le pieu de votre sexe, ils girent autour de votre ombilic, sucent sa sève où git encore une faible lumière; ils s'accrochent aux nervures de votre plexus; ils tapissent votre menton d'un miellat obscur, gluant; ils forent le puits de vos yeux, y déposent leurs œufs mortifères, leur lumière noire et les cerneaux en arrière de votre front, les scissures, les circonvolutions s'emplissent de bitume, sombres chaudrons où s'engluent les idées. Vous êtes un poète sans muse, un rhapsode à la langue soudée, vous êtes Homère aux yeux de pierre occluse.
Les mots n'habitent plus la cimaise de votre tête, ils l'ont désertée. Ils veulent être libres, ils veulent savoir, traverser la vitre glauque, la vitre aux couleurs métaphysiques où se reflète votre silhouette à la tempe abolie, ils veulent signifier par eux-mêmes, émettre leur petite lumière de luciole, leur mince flamboiement de lampyre parmi les herbes avant que la clarté ne sombre définitivement dans l'absurde. Vous êtes le Poète à la page blanche maculée d'encre, tachée d'écume noire. Les signes ont eu raison de vous, ils vous ont réduit à néant. Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus qu'une suite indistincte, un genre de pointillé dans l'oublieuse mémoire des hommes. Eh bien, oui, c'est cela même que vous pensez face à l'œuvre de De Chirico. Une pure abolition de tout ce qui signifie, éclaire, resplendit. Une aporie. La vie réduite à une abstraction, à un entrelacs de hiéroglyphes indéchiffrables. Indépassable, croyez-vous. Sans doute votre progression dans l'existence vous inclinait-elle à de telles pensées. Le grand âge frapperait bientôt à votre seuil avec l'obstination étroite du destin. Votre aventure picturale aurait à trouver un épilogue. Vous ne saviez pas encore lequel.
Pendant les jours gris, les jours étroits qui blanchiront vos tempes, vous serez assailli d'images pourtant familières, mais vous n'en serez plus maître. Elles s'imprimeront sur votre front ridé avec obstination, elles vrilleront votre tunique de peau, elles vous habiteront de l'intérieur. Les objets du quotidien, mis en scène par Tapies, vous les reconnaîtrez à peine, pas plus que vous n'identifierez les fragments de corps, les pieds, les mains, les troncs, les aisselles, les pilosités. Simples schizophrénies anatomiques dispersées au hasard des toiles. Anatomies sans langage. Seuls les signes abstraits vous parleront encore, mais indistinctement, comme articulés par des lèvres de pierre. Chiffres, lettres, griffures, scarifications émergeant à peine d'une matière confuse, primitive. Et puis les croix, les croix multiples, les croix omniprésentes, traits de fusain, traces de bitume, encres, huiles lourdes et poisseuses vous n'en percevrez plus que le clignotement existentiel en forme de finitude, le renoncement des jours à signifier hors du sombre, du noir, de l'occlusion. De cette suite de signifiants éteints ne pouvait que surgir l'inévitable "Carré noir sur fond blanc" de Malévitch. Perspective de clarté que vient annuler la large empreinte couleur de suie. Comme une limite ultime à laquelle s'arrêteraient tous les signes, les langages, les regards, tous les gestes, les progressions humaines. La "période Malévitch" serait constituée de ces crochets métaphysiques plantés dans votre chair, de ces pensées étiolées assiégeant votre conscience, de ces idées aussi lentes que la propagation de l'eau dans la densité des tourbières. Pour vous, la lumière ne serait plus présente, quelque part dans l'espace et le temps, qu'à titre d'hypothèse. Vous prendrez alors conscience que, pour pénétrer la lumière, il ne suffit pas de la poser devant soi et d'en décrire les facettes, les nuances. Il faut surtout parler de son ABSENCE, comme on parle de l'absence d'une personne élue. Il faut en être privé, dans la zone où plus rien n'arrive, là où les rayons se courbent, où les droites se brisent, dans le lieu d'une possible perdition. Dans un cachot, une crypte, une oubliette. Ne plus avoir d'issue. Se trouver confronté à la cécité, au non-voir dans sa dimension tragique, confondante. Cultiver le manque comme une fleur vénéneuse, mortifère. Oh, bien sûr, au début, l'ombre n'était pour vous qu'une sorte de voile posé sur les choses, une simple atténuation de leur présence, une faible dissimulation. Mais, malgré tout, vous la perceviez. Comme on perçoit une menace lointaine, enfant, une menace si peu réelle qu'elle semblerait ne pas devoir exister. Ainsi la finitude, par exemple. Se révélant comme une simple suite de mots que ponctuent quelques points de suspension. Ainsi l'obscur vous apparaîtra-t-il à la manière d'une ombre portée, abstraite, en quelque sorte. Etonnamment, c'est en pleine lumière qu'elle se révélera le mieux, qu'elle affirmera son emprise, imposera sa nécessité. Loi des contrastes. Illumination des intuitions fondatrices. Révélation métaphysique. Destins confondus, dans un même creuset, de l'ombre et de la lumière, à la façon d'une vibration : liseré inapparent d'où surgit le clair-obscur. Nullement une vérité qui reposerait sur des fondements logiques, rationnels, étayés. Tout est au-delà des significations quotidiennes, tout est situé dans une dimension thanatologique, métalogique, hors de portée. Comment la parole, le logos, dans leur déploiement, pourraient-ils rendre compte de cette césure du sens, de sa disparition ? Caractère déconcertant, vortex de la lumière où tourbillonne déjà l'œil glauque du néant. Vous n'y échapperez plus. Désormais vous ne serez, métaphoriquement parlant, qu'une surface lisse, une page blanche offusquée de signes. Votre peau ne sera plus que le palimpseste où s'écrira continuellement le chiffre obstiné du monde. Et vous ne pourrez enrayer cette marée, cette profusion de marques, d'empreintes, de poinçons, de tatouages, de traces, de sillages venus de toutes parts. Du reste, ces signes, jamais vous ne vous étiez attaché à les circonscrire, à en atténuer l'emprise. Bien au contraire, vous vous êtes acharné, votre vie durant, à les recueillir, à les collationner, à les archiver dans l'enceinte de votre corps. Signes du ciel et de la terre; signes des montagnes et des océans; signes des poèmes, de la littérature, signes de l'art. A l'intérieur de votre peau, c'est une immense Tour de Babel qui s'est constituée avec ses multiples langages, ses dédales de bruissements, de rumeurs, ses étages de mots, ses labyrinthes de significations. Seulement, la page blanche ,- l'essence -, a besoin d'un espace de jeu où faire courir la lumière. Seulement les signes ,- l'existence -, réduisent cet espace en le maculant de petites noirceurs obstinées, récurrentes, obsessionnelles. Combat immémorial de l'essence et de l'existence. Les signes, - le clignotement des étoiles, le rythme des marées, les œuvres des hommes, leurs gesticulations désordonnées, leurs trajets de fourmis pressées, seulement quelques tentatives laborieuses et éphémères pour tracer un destin, écrire une histoire, témoigner de ce que fut la vie, à un moment précis, sur un coin de la terre. Un passage, une ombre rapide parmi quelques éclairs de lumière. Au bout du compte, de la parole divine, du Fiat lux, l'homme ne retiendra que son injonction seconde "et lux fit", "et la lumière fut", point final à sa propre genèse.
Cependant, parmi les ombres denses , au milieu des œuvres saturniennes, sinueraient encore quelques filaments de lumière dans l'architecture convulsée de votre cortex. Quelques filaments auxquels s'accrocheraient, dans la plus étonnante des rencontres, les grands polyptiques de Soulages. Une manière de "re-naissance". Parvenu au stade "nocturne" de l'œuvre, vous aurez fait l'économie des années de jeunesse, celles au cours desquelles l'artiste, utilisant successivement goudron, brou de noix, gouache, encre, s'essaie à des variations autour du thème qui, depuis toujours, l'occupe, sans pouvoir encore le nommer d'une façon exacte, sans pouvoir en déterminer l'essence. Les couleurs y sont encore visibles, -bleus, rouges, marron -, même si, déjà, elles cherchent à jouer en contrepoint, à se dissimuler, à devenir muettes, en quelque sorte. Ce qu'elles font, soudain, à la faveur de multiples expériences plastiques, manière de survenue d'un sens nouveau, d'un chemin où creuser sa voie :
"Un jour je peignais, le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans formes, sans contrastes, sans transparences. Dans cet extrême j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. J'aime que cette couleur violente incite à l'intériorisation. Mon instrument n'était plus le noir mais cette lumière secrète venue du noir. D'autant plus intense dans ses effets qu'elle émane de la plus grande absence de lumière. Je me suis engagé dans cette voie, j'y trouve toujours des ouvertures nouvelles." (Pierre Soulages).
Alors naissent les grandes toiles. Le règne du noir y est omniprésent, ne laissant aucune autre couleur s'immiscer dans la composition picturale. Grâce aux empâtements, le noir est devenu matière, le noir est métamorphosé en objet, en texture vivante, vibrante. Les tableaux : rythmes de lignes; levées de peinture que séparent de grands à-plats; obliques vigoureuses; profonds sillons contrastant avec des surfaces lisses, polies; percussions de longs traits; griffures. Toute une géométrie où se joue la lumière, où dansent les reflets, où ricoche la clarté. Le noir-lumière; la lumière-noire, la lumière-chrysalide, la lumière-nymphe devenant imago aux contours multiples, à la polysémie ouverte. Car c'est bien là le prodige. Soudain, pour l'artiste confronté à l'acte pictural, c'est l'émergence d'une vérité, le déploiement en plein jour d'une pure évidence. Le noir, semblable à la larve inerte, invisible, inapparente, qui se transmue, en sphinx, en écaille, en uranie, en priam aux couleurs chatoyantes.
"Du sombre émanait une clarté".
Traduisons : "Du non-sens naissait le sens. Du secret la révélation. Du mutisme le langage." Geste inaugural du peintre. Geste allégorique reproduisant le Fiat lux divin.
"Cette lumière secrète venue du noir."
Comment mieux faire comprendre la singulière disposition de l'art à la transcendance, la genèse initiée par le geste pictural ? Mais lumière-crypte, sourde, qui ne peut se révéler qu'à l'aune d'une exigeante lucidité. Pour Soulages, seul le noir pouvait avoir cette profondeur, cette amplitude, cette plasticité au sein de laquelle inscrire la lumière, initier l'aventure ontologique, faire croître la genèse humaine, s'épanouir l'essence du langage.
Mais cette "lumière venue du noir", ne vous projette-telle pas, soudain, au sein même de votre expérience primitive ? Ne fait-elle nullement signe vers le germe humain, langagier, que vous symbolisiez au sein de la grotte originelle ? Vous n'étiez alors qu'une nymphe en attente d'imago, une graine destinée à s'épanouir. Vous étiez déjà, sans le savoir, dans cette "lumière transmuée par le noir", dans cet "outrenoir", tout près de la signifiance qu'ouvrirait bientôt en vous la clairière lumineuse des mots.
Ombre - Lumière - Ombre - Comme une symphonie à venir...






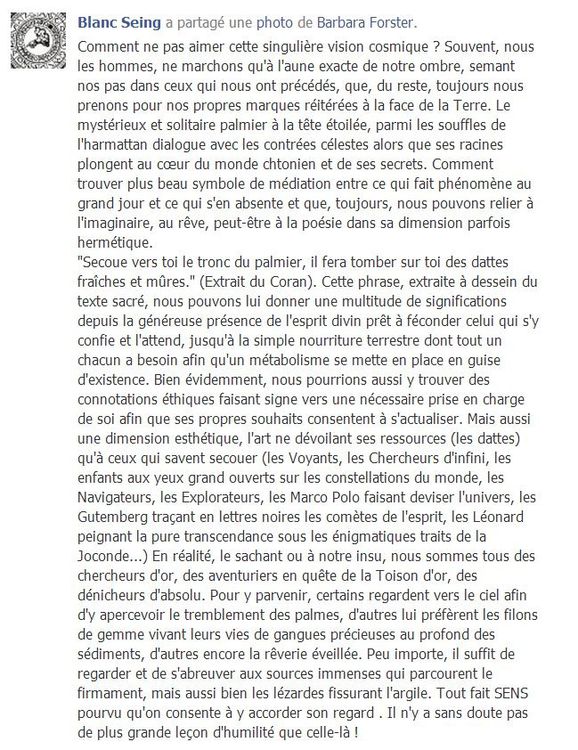









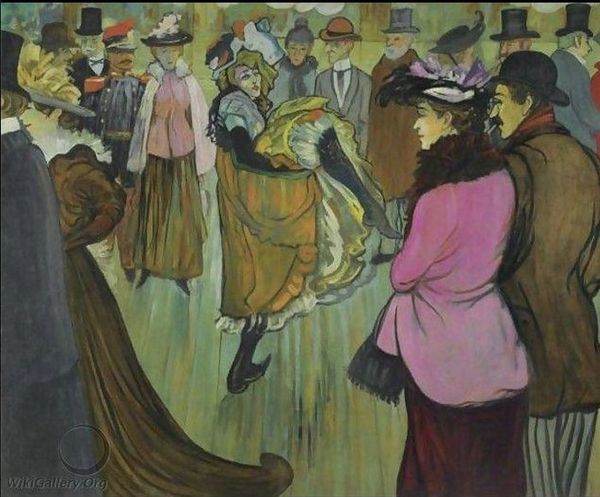

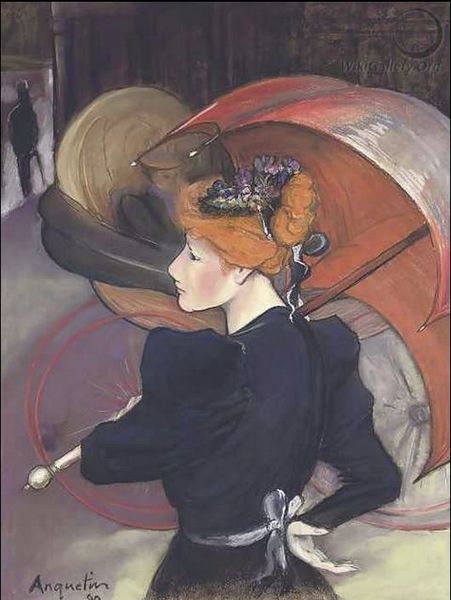


/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)