" Quand les nuages passent sur Grand Fort Philippe".
Photographie : Alain Beauvois.
« La Mer du Nord...
A l'horizon, dans le lointain : Calais
Entre les deux, les plages
" vers le Phare de Walde ",
les plages du Fort vert,
des Hemmes de Marck,
des Hemmes d' Oye,
des Escardines d' Oye Plage,
de Grand Fort...
Toutes ces plages
que j'aurai tant photographiées … »
A.B.
Il y a des courants, des brises marines, des départs et des retours, de sombres galeries s’ouvrant sur le passé, des volées d’escaliers surgissant en plein ciel, des chambres à l’odeur de naphtaline, les senteurs du pain grillé, des fontaines d’eau claire, il y a des résurgences et, soudain, la sortie dans la fente du jour. On est si peu assurés de soi, on hésite à se lever, à quitter l’antre de son lit, à déserter les murs de sa chambre. On était si bien, là, pliés dans la douceur du rêve avec ses effluves anciennes, ses cathédrales de nuages, ses étonnants sursauts, ses prodiges. On était soi, on était l’autre, on était ici et maintenant, on était ailleurs, dans un passé que le futur nous accordait, que le présent reprenait de ses mains pressées, on s’appartenait en même temps qu’on était hors de soi dans un pays aux contours flous.
On pousse les volets sur la clarté qui naît de la terre, pareille à une brume voulant gagner l’espace. Il fait chaud déjà et bientôt l’heure sera solaire avec ses crépitements, ses explosions nucléaires, ses cascades blanches tombant du ciel. La terre est fissurée, infiniment craquelée, peau de vieux reptile en attente de pluie. Les gorges sont sèches, les langues collent au palais, les poitrines sont oppressées. On cherche la fraîcheur, on pose sur la colline de son front des tissus d’eau fraîche, on longe l’ombre bleue dans les failles des rues. Si éprouvant de vivre et de devoir avancer vers un but qu’on ne connaît pas. On erre infiniment aux contours de soi et l’on n’arrive même plus à se reconnaître, à écrire sa propre biographie. La chaleur est une douleur, une hébétude qui nous maintient rivés au sol, cloués sur la planche de liège de l’entomologiste. Pensées lentes à venir, gluantes, visqueuses, à la consistance de tentacules. Alors on ramasse son corps de poulpe et l’on progresse, par petits bonds, à la vitesse des cloportes et l’on se dirige vers la mer, la grande étendue d’eau salée qui est aussi notre mère, notre lieu primitif d’apparition.
On s’assoit sur le haut du monticule de pierres, en position de penseur avec, autour de soi, le fouet de ses tentacules, ventouses collées aux certitudes de la roche, masse palpitante qui vit au rythme du flux et du reflux de l’eau. On est encore habités de la péninsule de l’imaginaire, des confluences du rêve, des persistances d’une inquiétude primitive. Mais peu à peu la conscience s’éclaire, le paysage trace son chemin, tout là-bas vers l’horizon où vivent les hommes. Soudain on est si bien ici, tout près du champ de neige de la plage, de ses congères rassurantes. En bas, couleur d’étain, coule le fleuve maritime que la mer a laissé derrière elle comme un témoin de sa puissance, de son règne infini, de son aptitude à régénérer tout ce qui vient à sa rencontre. La brise est douce qui fait son agitation de palme, ses friselis sur la dalle d’eau. La chaleur est un souvenir qui se dissout dans l’immensité. Ici est le dire libre de l’existence, l’amplitude de la Nature, l’ouverture de l’espace au chant de l’univers. Les soirs d’étoiles, lorsque leurs rayons trouent le ciel bleu indigo, c’est un ressourcement que de s’allonger sur le plateau de sable et de regarder simplement la giration du ciel, les traits et les pointillés de lumière, la fuite des comètes, les gerbes d’étincelles. Minuscules sémaphores parlant le seul langage compréhensible, celui de l’harmonie universelle, de la liaison des choses entre elles, de la non-séparation comme principe premier dont il faut ressentir au-dedans de soi la force unique d’aimantation. Tout est dans tout dans une seule et même décision de parution. Les phénomènes font leurs minces clignotements pour nous dire ceci : ils sont nous comme nous sommes eux, nous vivons au même rythme, nous respirons le même air, nous buvons la même eau. Quel bonheur, alors que d’expérimenter cette union qui nous porte au-delà de nous dans la contrée illimitée de la sensation ouverte. Combien les fadaises urbaines nous paraissent superficielles, inopérantes. Combien les discours des agoras humaines nous semblent résonner dans le vide et l’inaccompli.
Mais regardons seulement le jeu subtil des courbes, la fuite du fleuve comme une coulée de métal en fusion, la trace de cendre du grand lac marin qui, bientôt, ondulera sous la poussée des flots. Mais observons le ciel si pâle, presque inapparent, que vient recouvrir le nuage au ventre sombre, lourd, aux si belles tonalités élémentaires, alternance de noir et de blanc, empreinte du jour et de la nuit. Le temps y est inscrit dans la rumeur même de cette double valeur, scintillement de l’heure dont naissent les secondes, leur pluie incessante, leur rythme si proche du nôtre, battements du cœur du monde se superposant à ceux des hommes à la destinée exacte. Oui, « exacte » car nous sommes un rouage de la grande horloge qui scande le temps des planètes et nous sculpte à notre insu, tout comme la mer façonne le rivage en y déposant son immémoriale empreinte.
Les nuages flottent haut dans la canopée céleste. Il n’y aura pas d’orage venant rafraîchir la mémoire oublieuse des hommes, pas d’eau fécondant les terres de l’esprit, pas de brume entourant l’âme de sa présence cotonneuse. Seulement une longue dérive des choses sous la courbe haute de la lumière. Alors les Existants rentreront dans la fraîcheur de leur logis et adresseront au ciel des prières afin qu’il pleuve et que leur corps habite la Terre à la manière d’une glaise souple, d’un humus dont ils tirent leur propre substance depuis la nuit des temps. Lovés dans leurs chambres aux murs de chaux claire, ils dériveront longuement dans le labyrinthe du rêve, s’inscrivant dans cette géographie du doute qui toujours nous visite dès l’instant où nous nous mettons en vacance du monde et de son langage. Sans doute le temps est-il venu de dialoguer. Avec nous d’abord, avec tout ce qui signifie sur l’ensemble de la Terre, ensuite. La tâche est immense qui nous est confiée ! Ô combien exaltante. L’ensemble de notre dérive terrestre n’en viendra sans doute pas à bout. Raison de plus pour nous embarquer pour l’aventure hauturière. La mer n’attend pas !












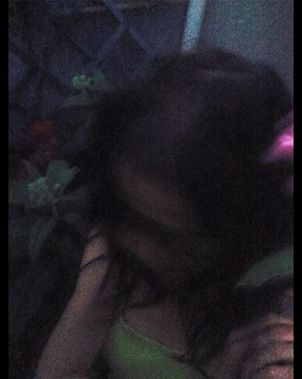
/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)