"Inutile ostentation".
Œuvre : André Maynet.
« Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien ; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. »
Jacques le fataliste et son maître - Denis Diderot.
Dire combien ce lieu sans lieu, ce temps sans temps étaient étranges, dépasse tout entendement fût-il rompu aux subtilités intellectives. Il s’agissait d’une manière d’Utopia, de Nusquama, de « Nulle-part », qu’on eût pu désigner aussi bien du prédicat d’«Abraxa », cette ville des fous dont Erasme rend compte dans son « Eloge de la folie ». Oui, de la folie. Car comment disposer d’une position stable, comment figurer sous la majesté d’une humaine silhouette lorsque vous désertent aussi bien le site d’une origine que ce qui, par essence s’y attache, à savoir l’architecture d’une identité ? On avançait au hasard sur la dalle grise et anonyme. On poussait ses pas dans un étrange sur-place, à la façon des mimes qui ne progressent que dans leur propre rêve et dans les fantasmes des Voyeurs qui, par eux, les mimes, se laissent fasciner. La réalité était si peu préhensible (mais qu’était donc la réalité dans cette pliure du songe ?), les choses si peu concevables qu’on existait comme en sustentation, pareils aux araignées d’eau qui frôlent le miroir de l’onde sans même le toucher, simples irisations de l’instant suspendu qui, jamais, ne retombe. Alors tout est immobile, silencieux. Nul langage n’existe sauf celui d’une réverbération des corps dans le tain impalpable d’un improbable miroir.
Il semblait qu’au-dessus de cette densité grise, de cette inconcevable brume, flottait un impératif. Nullement une imprécation qui eût rompu le charme à l’aune de son brutal couperet. Plutôt une insinuation cachée, peut-être une souple incantation ou bien la rumeur d’une prière logée au creux d’une mystérieuse crypte. Simplement, sans doute, celle des corps où ruisselait l’effeuillement d’une mutité. C’est ainsi, les atmosphères insolites conduisent l’âme à ne rien proférer qui entaillerait le jour. Seulement un murmure, un éthéré bourdonnement faisant son bruit de ruche en arrière de la falaise blanche des fronts. Ce qu’on voyait dans cette illusion souveraine : une Innommée au long corps d’albâtre, une liane sans début ni fin, une légère torsion du buste accomplissant un retour vers un proche passé, une hypothétique interrogation muette ou bien un questionnement inquiet. On ne pouvait guère savoir au-delà de cette posture immatérielle réduite à sa fixité, comme si une angoisse en tendait silencieusement la membrane de peau, comme si un cri anciennement proféré s’était cristallisé dans une intangible concrétion.
Dans un plan plus éloigné, peut-être à l’angle d’un jour appartenant à une antique mémoire (mais comment parler de « passé » alors même que le temps semble ne devoir jamais surgir ?), une autre Innommée à la taille menue de guêpe, aux longs bras, deux brindilles en attente d’être, deux jambes infinies qui plantent leurs racines dans un brouillard lagunaire, avec, pour vêture, un seul bas couleur de chair et d’aube irrésolue. Le visage est un masque de porcelaine pareil à ceux qui hantent la Cité des Doges, près des canaux aux réverbérations d’étain. La coiffe est une efflorescence rose et bleue qui fait l’unique tache de couleur dans l’estompe de l’heure, une légère mélodie posée sur le camaïeu des choses invisibles. Certes tout ceci, ces touches subtiles, cette improvisation des teintes natives, ce pastel n’osant dire son nom sont si peu affirmés qu’on pourrait en considérer la manifestation inapparente et sans autre valeur que ce grésillement, ces quelques césures inaperçues dans la percée du poème. Seulement penser ceci, cette inattention à accorder à une parution discrète, presque inapparente revient à biffer ce qui, de la présence, vient à notre encontre dans la seule mesure qui soit : celle d’un sens à connaître.
Mais rien ne servirait d’épiloguer, de broder, de festonner des phrases autour de Celle qui, se voulant inapparente, se traduit en réalité comme le début d’un alphabet chromatique, l’initiale d’un chant qui, bientôt, dépliera ses volutes, affirmera sa distance, prendra son envol, quittant la dalle originelle qui l’a enfantée. Cet essai de s’exiler du sol premier, de s’affranchir du lieu de sa naissance, de son site fondateur, rien ne le rendra plus visible que l’attitude de la troisième Innommée (nommons-la provisoirement ainsi), cette petite fille apeurée qui cherche la protection de Celle qui accepte de la prendre en garde. Deux silhouettes faisant corps dans un genre d’affinité qui les confond en un ressenti commun. Y aurait-il danger ? Quelque chose comme une « inquiétante étrangeté » pourrait-elle surgir à tout moment qui menacerait, remettrait au néant ce qui vient de dévoiler son être comme l’une des actualisations de ce qui vient au paraître ?
Oui, cette image toute en tension, ourlée d’un tragique discret nous invite à réfléchir à ce que veut dire prendre nom et croître sur la Terre, sous le Ciel où glissent les nuages, ces fugaces harmonies traçant le destin de l’éther tout comme le sol imprime en nous ses racines nourricières. Être nommé ne veut pas seulement dire prendre son envol à partir d’une quelconque effusion, d’un premier prédicat venu, fût-il événement sous les espèces d’une frise florale venue ceindre un front soucieux de connaître le vaste monde et ses myriades de mouvements colorés, ses miroirs éblouissants, ses infinis carrousels, ses fragments de changeant kaléidoscope. L’être de toute Innommée est toujours en attente d’un nom mais celui-ci n’est jamais libre de s’affranchir du territoire à partir duquel il a pris essor. La bonne décision : demeurer au centre de soi, si près de sa texture originelle que jamais son être ne s’absentera, quand bien même on tâcherait de lui donner une impulsion différente de celle qui, de toute éternité, lui a été assignée comme son chemin le plus juste. Ceci s’appelle Destin que guident les Moires, filles d’Erèbe et de la Nuit. La première de ces filles file le fil du destin, la seconde le mesure avec une baguette, la troisième le tranche. Inévitable succession de jours heureux et d’heures sombres. Il n’est que de connaître ce clignotement qui fait sens et s’appelle l’exister. Tout est déjà inscrit dans le sol qui nous a vus naître, tout comme sur « le Grand Rouleau » qui inspire tellement Jacques le fataliste. D’une manière ou d’une autre, fût-elle terrestre, fût-elle céleste il nous faut être reliés. Ainsi prenons-nous nom de notre saut qui n’est qu’un essai de paraître le temps d’une brève illumination !
Ainsi se justifie le titre donné par l’Artiste à son œuvre : « Inutile ostentation », puisque, aussi bien, incliner son paraître de telle ou de telle manière est une ostentation, une prétention à être qui nous dépasse et devrait nous reconduire à cette vertu d’humilité qui est, sans doute, le bien le plus précieux auquel nous puissions confier nos modestes destinées.













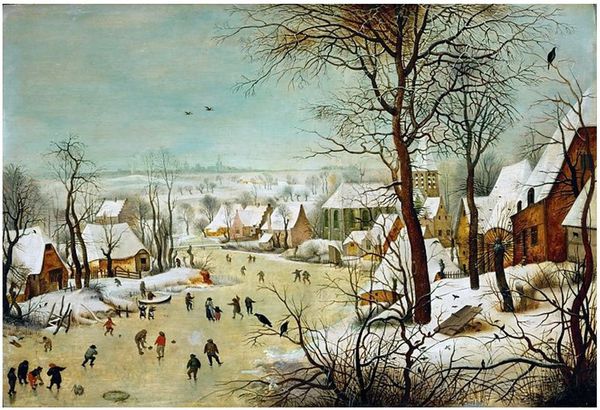
/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)